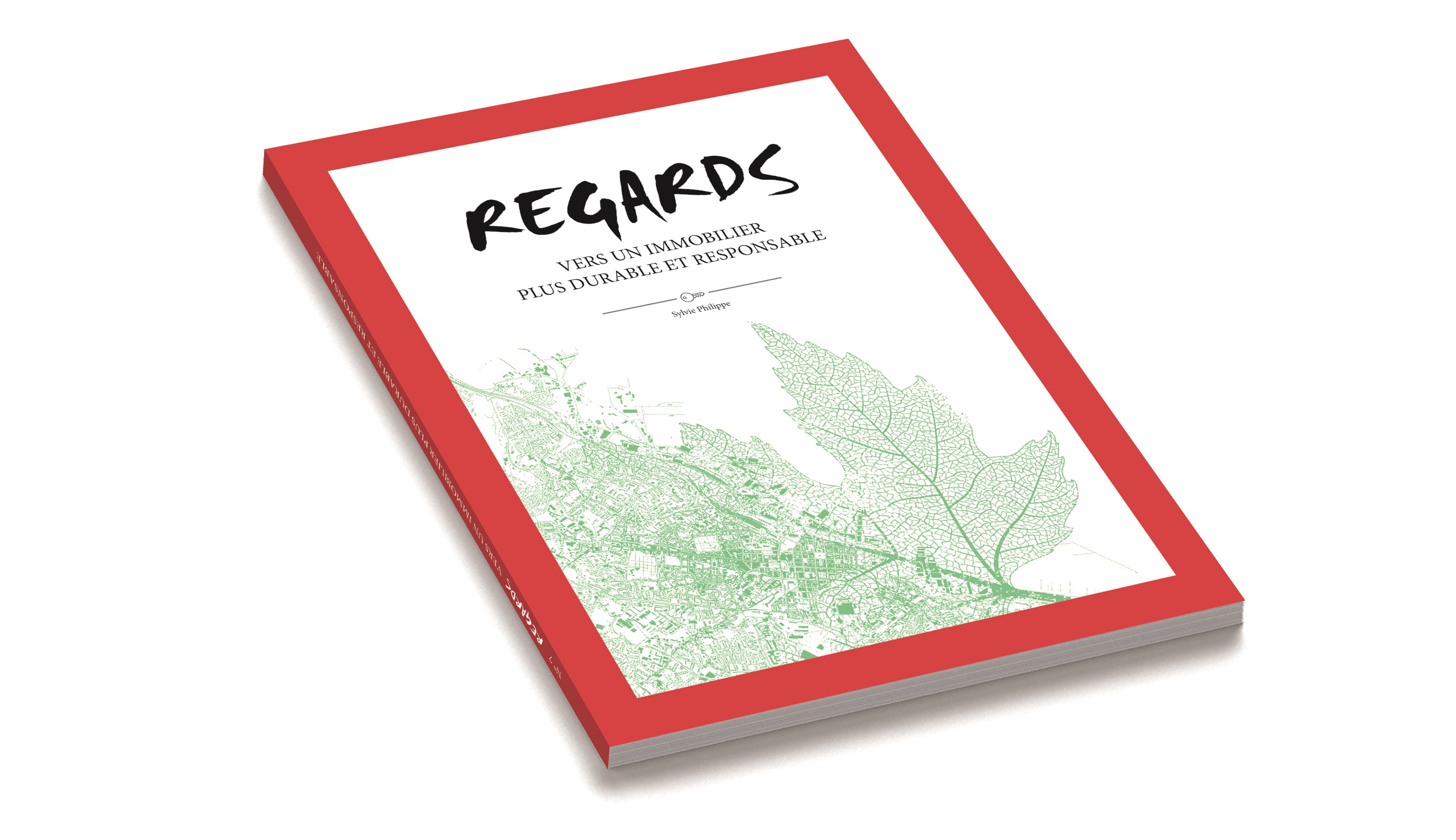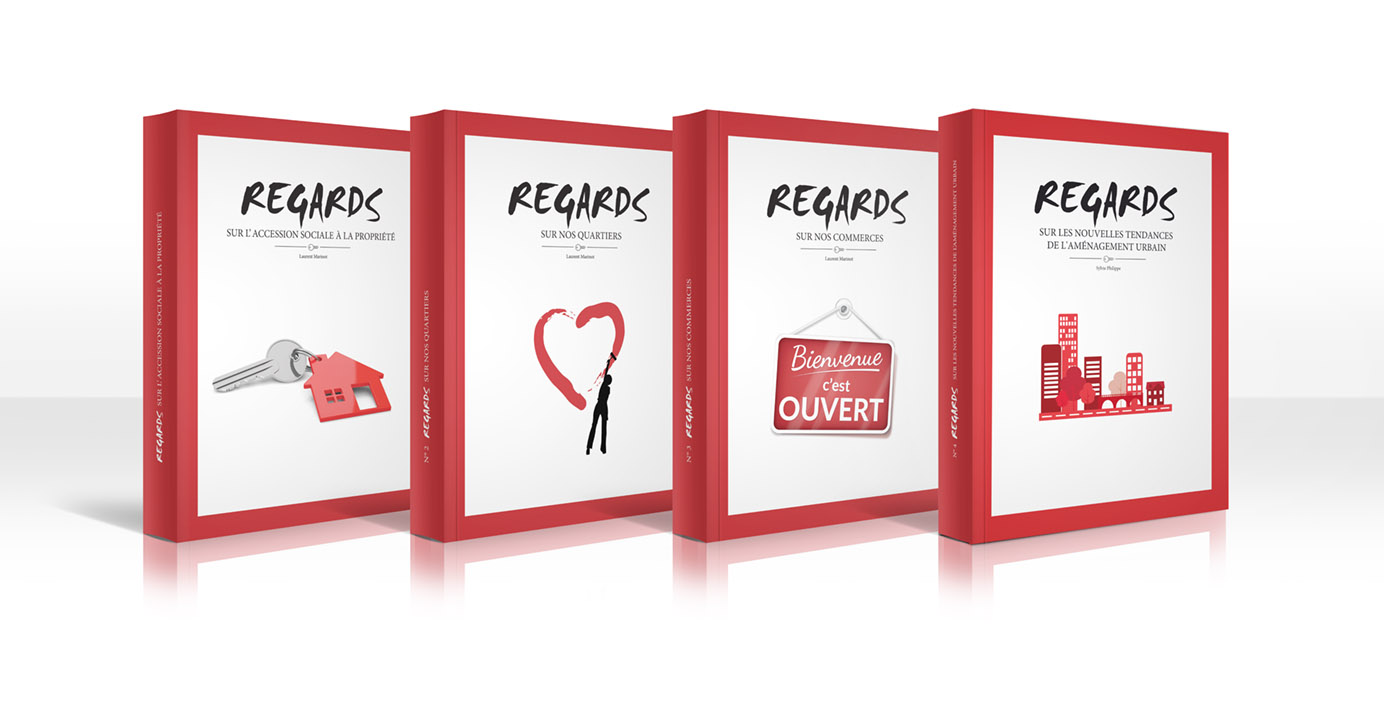Archives du 16 juillet 2019
EuroRennes, le projet qui vient transformer le cœur de la métropole @Demain_la_Ville
Source : Demain la ville
Depuis 2010, la création de la ZAC EuroRennes vient peu à peu transformer le quartier de gare et devient peu à peu un véritable symbole d’attractivité. Comment le projet EuroRennes transforme t’il l’histoire de la ville ? La nouvelle gare est-elle le point de départ d’un renouveau de la Métropole ?

Eurorennes, quand un quartier de gare se redessine
C’est lors de la construction de la ligne ferroviaire Paris Montparnasse – Brest, que la ville de Rennes se dote la première fois d’une gare en 1854. L’implantation de celle-ci bouleverse déjà à l’époque la ville. Autour des ateliers de la gare s’installent les cheminots et leurs familles, construisant eux-mêmes leurs habitations et provoquant une urbanisation lente et peu contrôlée de ses environs. Ce quartier populaire reste pendant très longtemps, coupé du reste de la ville malgré sa proximité avec le centre urbain. Les grandes infrastructures ferroviaires sont en effet des barrières qui empêchent la communication des espaces urbains autour de la gare avec le reste de la ville, même si certaines percées et aménagements ont été mises en place.
Et depuis 2010, c’est l’entièreté de ce quartier de gare qui subit une grande transformation. Avec comme slogan : “EuroRennes, Porte d’entrée de la Bretagne cœur de Métropole”, l’ambition portée par la ZAC est clairement affichée. Au centre du projet, la reconfiguration du pôle ferroviaire apparaît comme la clé de voûte d’un projet d’envergure métropolitaine. Porté par Rennes Métropole et Territoires Publics, ce vaste projet de 58 hectares participe pleinement au renouveau urbain de la ville. Mais alors derrière cette reconfiguration, quelles sont les attentes des différentes parties prenantes du projet ? Comment la ZAC EuroRennes vient transformer, non seulement la ville, mais aussi son image ? Et plus généralement, qu’est-ce que les grands projets urbains racontent de l’évolution des métropoles ?
Reconnecter le quartier de gare avec le reste de la métropole rennaise
La transformation du quartier de gare permet dans un premier temps son ouverture sur le reste de la ville, mais aussi de gommer la fracture physique et psychologique propre à ce quartier. Prenant place de chaque côté de la voie ferrée, le projet cherche avant tout à recréer des liens physiques entre le Sud et le Nord de Rennes. La restructuration de la gare permet donc d’assurer cette continuité entre ces deux espaces : une nouvelle liaison piétonne est dessinée pour relier les deux parvis de la gare, et pour traverser les voies ferrées. Cet ensemble paysager se veut également être le pivot de ces deux parties de la ville, améliorant de fait les flux piétons et les mobilités douces.