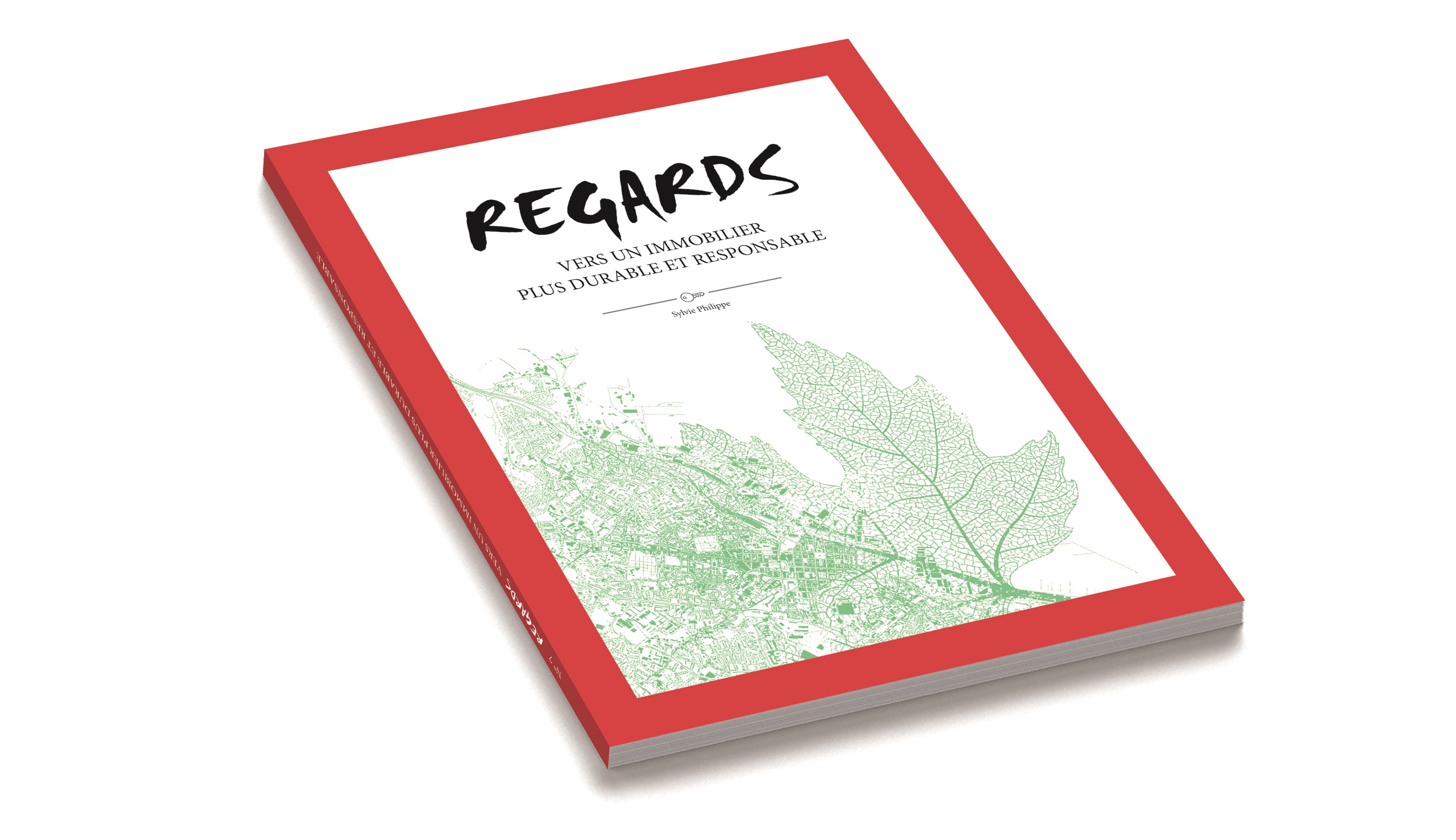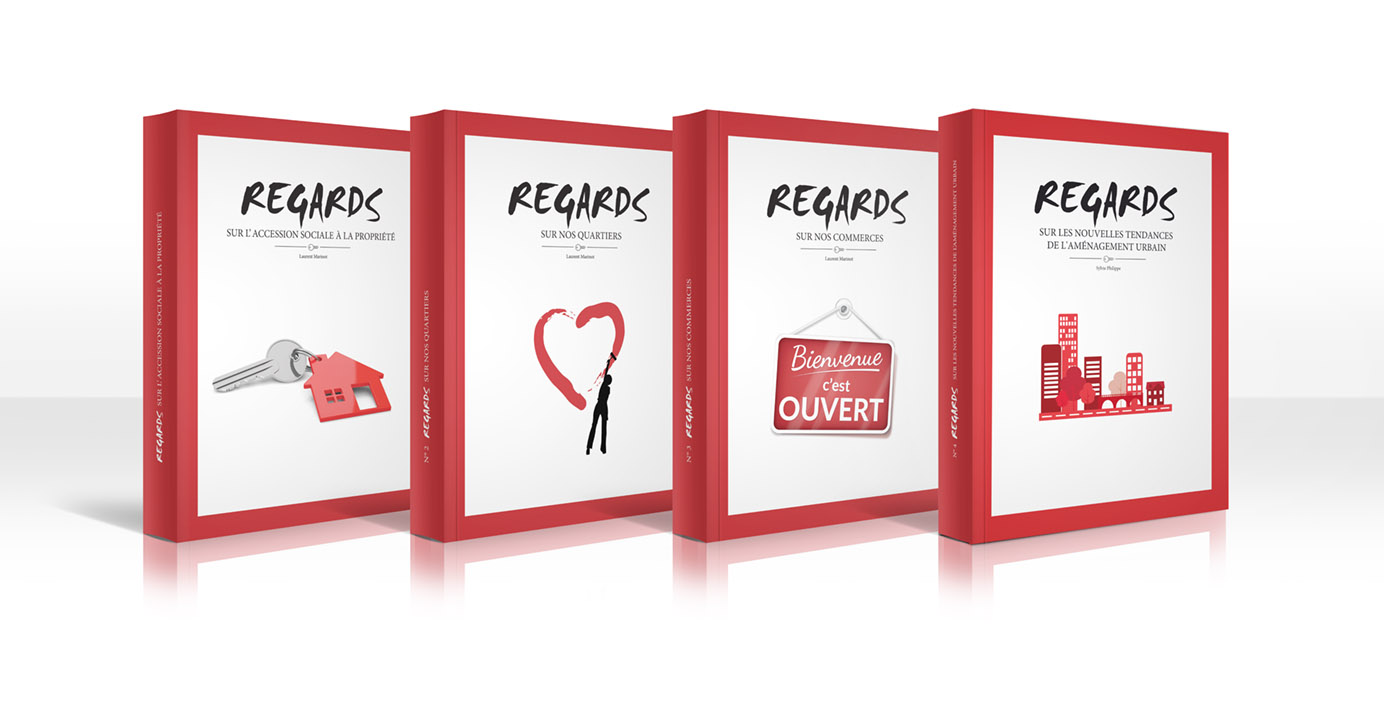Archives du blog
Airbnb : 8,5 millions de Français utilisateurs cet été @airbnb_fr
Source : Airbnb

La célèbre plateforme Airbnb ne cesse de prendre de l’ampleur. En effet 8,5 millions de Français l’ont utilisé du 1er juin au 31 août pour leur hébergement de vacances. Deux millions d’entre eux ont choisi Airbnb pour la première fois pour réserver leurs séjours de vacances à travers le monde.
Cet été les Français ont encore une fois choisi la France : 60% des voyageurs Français ont ainsi (re)découvert l’Hexagone et les richesses de ses territoires avec Airbnb. Les régions qu’ils ont le plus plébiscitées sont les suivantes :
- Provence-Alpes-Côte-d’Azur
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bretagne
De nombreux voyageurs français ont d’ailleurs privilégié des vacances près de chez eux, l’occasion de profiter de la diversité de notre patrimoine touristique sans les contraintes d’un long voyage. Ainsi près d’un million de Français ont séjourné dans leur propre région cet été avec Airbnb. Les champions du voyage de proximité cet été en France sont les voyageurs d’Auvergne-Rhône-Alpes, suivis par ceux de Nouvelle-Aquitaine, d’Occitanie, de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et d’Ile de France.
Les voyageurs de l’Hexagone qui ne sont pas restés en France ont favorisé les pays voisins comme lieu de villégiature, notamment l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni…Lire la suite…
Villes étudiantes : quelles sont les plus chères de France ? @UNEF
Source : UNEF
Découvrez le classement 2019 des villes les plus chères de France selon le coût de la vie étudiante. Entre le logement et le transport, de nombreuses inégalités et différences persistent chaque année… Quelles sont les 10 villes les plus chères ? Quelles sont les 10 villes les moins chères ?

L’accès au logement : première source d’inégalités territoriale
Les disparités dans l’accès au logement pour les étudiant·e·s sont très importantes l’écart du loyer mensuel moyen entre la ville universitaire la plus chère (Paris avec 873 euros) et la ville la moins chère (Le Mans avec 340 euros) est donc de 533 euros par mois. Avec 3,86% d’augmentation des loyers au niveau national, la rentrée 2019 est celle de l’explosion des coûts des logements tandis que les aides au logements (APL) sont quant à elle gelée. Les dépenses en logement des étudiant·e·s deviennent donc de plus en plus importante, il est donc urgent de généraliser l’encadrement des loyers à toutes les villes universitaires afin de protéger l’accès des étudiant·e·s à des logements abordables et décents sur leur lieu d’étude.
L’accès aux transports : des évolutions disparates des tarifs et des inégalités territoriales importantes :
L’évolution des tarifs étudiants dans les transports en commun est très disparates en fonction des politiques locales mises en œuvre par les collectivités territoriales. En effet de nombreuses villes ont fait le choix de diminuer leurs tarifs cette année ou encore de créer des tarifs spécifiques pour les boursier(e)s alors que dans le même temps d’autres villes continuent d’augmenter chaque année les tarifs, précarisant de plus en plus les étudiant(e)s.
Classement des villes étudiantes les plus chères de France :
1. Paris : 1288,83 €
2. Nanterre : 1140,65 €
3. Créteil : 1084,65 €
4. Guyancourt : 1066,65 €
5. Champs sur marne : 1049,65 €
6. Saint Denis : 1041,65 €
7. Cergy : 1020,65 €
8. Orsay : 1018,65 €
9. Evry : 1017,65 €
10. Nice : 1002,83 €
11. Bordeaux : 962,45 €
12. Lyon : 962,41 €
13. Aix en Provence : 946,08 €
14. Marseille : 914,08 €
15. Lille : 912,95 €
Cliquez ici pour voir le classement des 40 villes
Lire aussi :
Collectivités locales : lancement d’un guide pour encourager les coopérations et mutualisations @Min_Territoires
Source : Ministère de la cohésion des territoires
Les ministres Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu ont adressé aux territoires un « guide des coopérations » afin de faciliter, d’encourager la coordination et la mutualisations des actions des collectivités locales.

Souvent, les collectivités s’estiment démunies pour envisager des coopérations ou des mutualisations. Pourtant beaucoup d’outils ou d’instruments existent déjà, mais ils sont souvent méconnus. C’est le sens du « Guide des coopérations » que le ministère a adressé aux collectivités locales. Il recense les différents dispositifs existants leur permettant de mettre en commun leurs moyens et de coordonner leur action en vue de l’élaboration de leurs projets : mutualisation des services supports ou missions fonctionnelles comme les ressources humaines, l’ingénierie, l’administration… ou mutualisation des compétences ou missions opérationnelles.
Cinq formes d’actions de mutualisation et de coopération, selon des degrés d’intégration croissants :
1. Une action est effectuée de manière coordonnée par deux ou plusieurs partenaires, sans création de structure commune (par exemple, dans le cadre d’un groupement de commande) ;
2. un partenaire confie à un autre le soin de réaliser une mission pour lui (par exemple, dans le cadre d’une prestation de service) ;
un partenaire met ses moyens au service des autres personnes publiques (mise à disposition de services ou d’équipements par voie de convention) ;
3. un des partenaires crée en son sein un service mutualisé spécifique qui intervient pour tous les participants (création de service commun) ;
4. les communes transfèrent une ou plusieurs de leurs compétences vers un EPCI qui les met en œuvre pour tout le territoire concerné.
Consultez le guide des coopérations
Lire aussi :
1er parc photovoltaïque dans le Lot de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) @caissedesdepots
 Source : caisse des dépôts
Source : caisse des dépôts
Les 11 520 panneaux solaires du parc photovoltaïque de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) de Gramat (Lot) viennent de produire leurs tout premiers kilowatts heure ! Ce nouveau parc illustre l’engagement de la CNR dans les énergies d’avenir aux côtés et au service des territoires.
Le projet, lauréat de l’appel d’offres national de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour les installations photovoltaïques de grande taille, a été mené par la CNR en lien avec les acteurs locaux :
- des entreprises locales et régionales se sont chargées des infrastructures ;
- le parc est situé sur une ancienne décharge municipale, réhabilitée par la collectivité.
Les premiers kWh ont été injectés sur le réseau le 23 juillet, avant la mise en service définitive du parc qui aura lieu en septembre, après les phases de test. Le parc de Gramat produira 7 gigawatts heure par an, soit la consommation électrique de 2 900 habitants, et permettra d’éviter le rejet de 4 660 tonnes de CO2. Le développement du parc a nécessité un investissement de 4,6 M€. La Caisse des Dépôts, actionnaire de la CNR, entera au capital de la société de projet à hauteur de 50% en septembre.
Depuis le début des années 2000, la CNR, dont le premier métier est de produire de l’hydroélectricité, se diversifie dans les énergies renouvelables. Elle a ainsi mis en service sa première centrale photovoltaïque en 2008 sur le toit de sa centrale hydroélectrique de Bollène (Vaucluse), et a développé depuis 28 centrales solaires.
Aujourd’hui, la CNR envisage de nouvelles formes de parcs solaires : …lire la suite…
 Source :
Source :