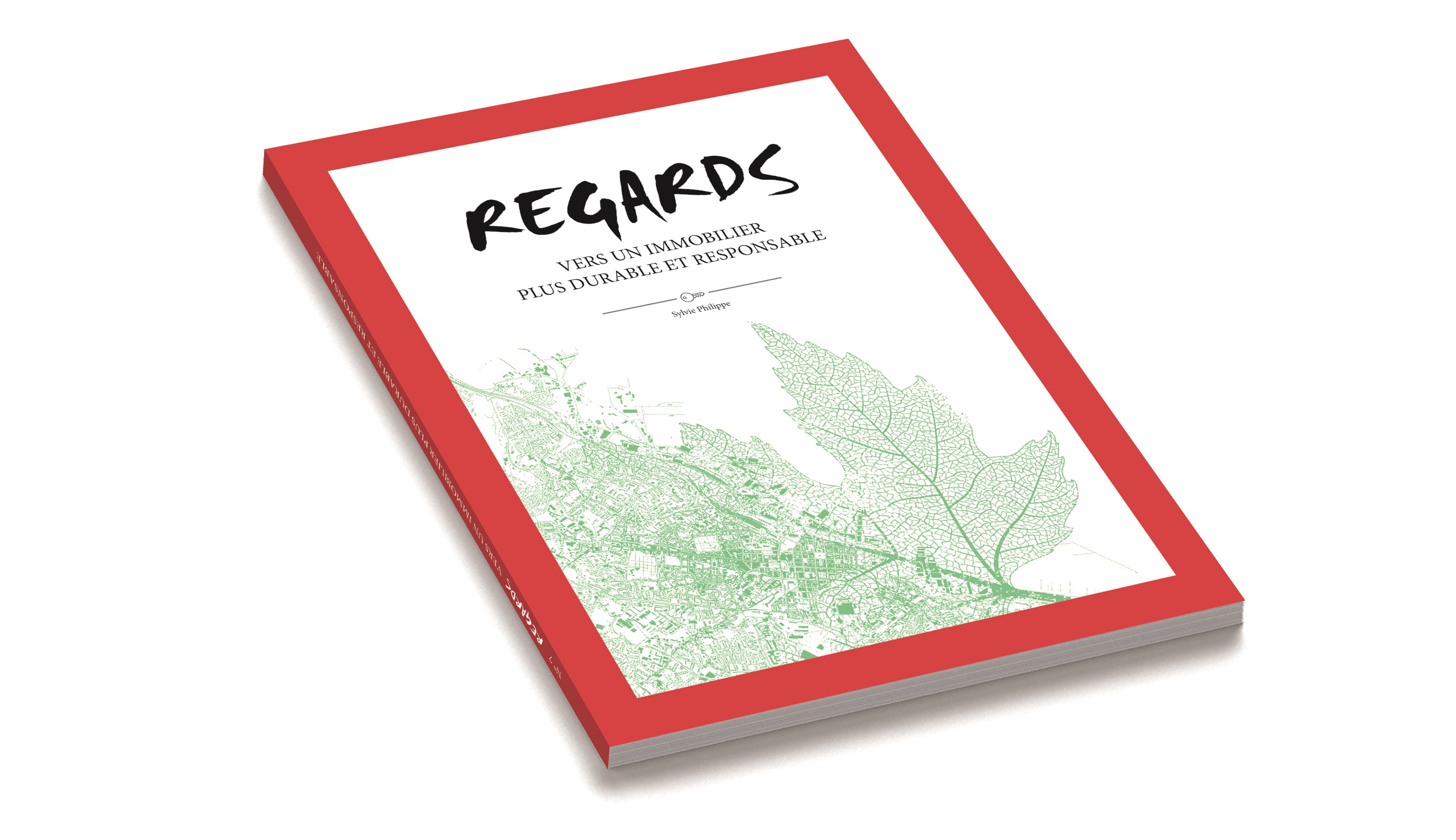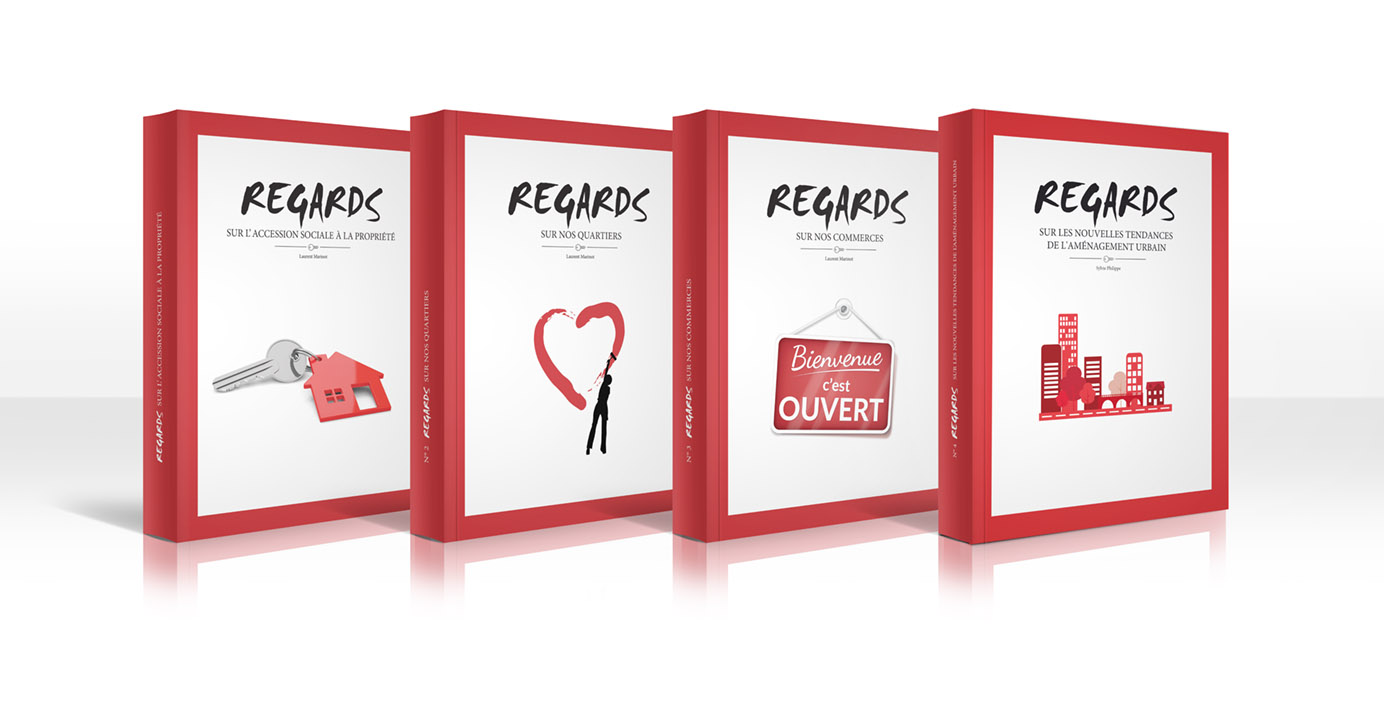Archives du blog
Métropole du Grand Paris : les lauréats de « Nature 2050 » dévoilés @GrandParisMGP #Nature2050
Source : Métropole du Grand Paris
Les lauréats de l’appel à projets « Nature 2050 – Métropole du Grand Paris » ont été dévoilés le 2 juillet dernier. En présence de plusieurs Maires et partenaires, la Charte Métropole Nature a été également signée lors de cet événement.

9 lauréats retenus dans le cadre de l’appel à projets « Nature 2050 »
Lancé en février 2019 par la Métropole du Grand Paris et CDC Biodiversité, l’appel à projets « Nature 2050 – Métropole du Grand Paris » vise à soutenir des actions portées par les communes et les territoires pour déployer le programme Nature 2050 dans le périmètre métropolitain. Conduit en partenariat avec des scientifiques, des acteurs publics, et des associations environnementales, ce programme repose sur l’engagement volontaire des acteurs économiques privés ou publics à agir, au-delà de leurs obligations réglementaires.
Parmi 26 projets, le Bureau de la Métropole du Grand Paris du 2 juillet qui s’est tenu précédemment dans la journée, a adopté à l’unanimité les 9 projets lauréats pour un montant total de 1,9 million d’euros. Des financements complémentaires seront apportés aux projets lauréats par les entreprises franciliennes, notamment pour en assurer le suivi et l’évaluation jusqu’en 2050.
Les lauréats :
– Arcueil pour son projet « Création de vergers urbains ouverts »
– Kremlin-Bicêtre pour son projet « L’escale végétale »
– Meudon pour son projet « Restauration écologique du Cimetière des Longs Réages »
– Plaine Commune pour son projet « Restauration des franges végétalisées du square Aimé Césaire » à Aubervilliers
– Plaine Commune pour son projet « Restructuration d’habitats boisés au Parc Marcel Cachin à Saint Denis
– Plaine Commune pour son projet « Ouvrir un coeur vert support de biodiversité et d’usages (ZAC des Tartres) à Stains
– Rueil-Malmaison pour son projet « Renforcement de la Trame Verte et Bleue communale »
– Villeneuve-le-Roi pour son projet « Le village aux 4000 arbres »
– Vitry-sur-Seine pour son projet « Les prairies du Fort »
Aménagement : focus sur la transformation de 7 grandes places parisiennes @Paris
Source : Paris
Les places de la Bastille, des Fêtes, Gambetta, d’Italie, de la Madeleine, de la Nation et du Panthéon sont des espaces emblématiques de Paris. Leur transformation et leur réaménagement est donc une vraie nécessité afin de rendre la ville plus accessible, plus verte et plus belle. Focus sur ces différents projets de réaménagement…

Quels sont les objectifs pour ces réaménagements ?
– Conforter le rôle de ces places comme des lieux de vie, en phase avec les nouveaux usages de l’espace public, pour tous.
– Favoriser les mobilités douces et les transports en commun, et de prendre en compte les besoins des personnes en situation de handicap.
– Revaloriser le patrimoine exceptionnel de ces places et de renouer avec leur histoire.
– Garantir la place de la nature dans la ville, et de prendre soin de l’environnement.
Une démarche collective inédite
Parce que leur transformation était un enjeu de qualité de vie, ces places ont fait l’objet d’une démarche innovante axée sur la participation citoyenne et la préfiguration.
Dès 2015, via une plateforme numérique dédiée pour recueillir l’opinion des citoyens, des contributions sur registre dans le cadre d’une exposition dans les mairies d’arrondissements et dans le cadre d’une concertation menée auprès des riverains, des conseils de quartier, mais aussi des associations de piétons, de cyclistes, de personnes en situation de handicap, traitant des questions de genre, notamment de la place des femmes dans l’espace public
Des évolutions structurelles vitales
Paris se transforme pour mieux respirer. L’avènement du « tout voiture » a fait de la capitale une métropole encombrée, polluée, où l’espace et l’énergie sont excessivement consommés. L’objectif est clair : assainir, libérer le Paris d’aujourd’hui et de demain.
Lire aussi :
Projet d’aménagement : comment obtenir le label EcoQuartier ? @Min_Territoires
Source : Ministère de la cohésion des territoires
La démarche de labellisation « EcoQuartier » comporte 4 étapes, correspondant aux différents stades du projet : l’idée, et la conception, la mise en chantier, la vie de quartier, et son amélioration continue avec et pour ses usagers. Voici la démarche à suivre pour obtenir la labellisation :

Un ÉcoQuartier est un projet d’aménagement urbain qui respecte les principes du développement durable tout en s’adaptant aux caractéristiques de son territoire. Le ministère s’est doté d’un référentiel en matière d’aménagement durable
Etape 1 : L’ÉcoQuartier en projet
Le label ÉcoQuartier – étape 1 est obtenu par la signature de la charte ÉcoQuartier par les élus et leurs partenaires pour le projet concerné. L’enregistrement du projet sera fait sur une plateforme très simple et rapide. Cette étape correspond au démarrage de la phase d’étude du projet par la collectivité locale.
Dès cette étape, le projet est répertorié comme « labellisé étape 1 » dans la communication nationale.
Etape 2 : L’ÉcoQuartier en chantier
Une fois les études achevées et le chantier engagé, une expertise du projet est réalisée pour vérifier la conformité du projet à la charte ÉcoQuartier. Les conclusions de cette expertise sont débattues avec la collectivité et ses partenaires, afin d’ajuster si nécessaire les suites du projet.
Le label ÉcoQuartier – étape 2 est délivré par la commission nationale ÉcoQuartier sur proposition de la commission régionale, après présentation des conclusions des experts.
Etape 3 : L’ÉcoQuartier livré
Dans les mêmes conditions que l’étape deux, lorsque l’ÉcoQuartier est livré (ou quasi livré), une expertise est réalisée pour l’obtention du label ÉcoQuartier – étape 3. Le label ÉcoQuartier – étape 3 est délivré par la commission nationale ÉcoQuartier sur proposition de la commission régionale, après présentation des conclusions des experts.
Etape 4 : L’ÉcoQuartier confirmé
Trois ans après l’obtention du label – étape 3, la collectivité mesure la tenue de ses engagements dans le temps, la façon dont les usages projetés sont appropriés par les usagers du quartier. Par ailleurs, elle présente également la façon dont les pratiques d’aménagement ont évolué au sein de la collectivité, au-delà du périmètre opérationnel du quartier.
Lire aussi :