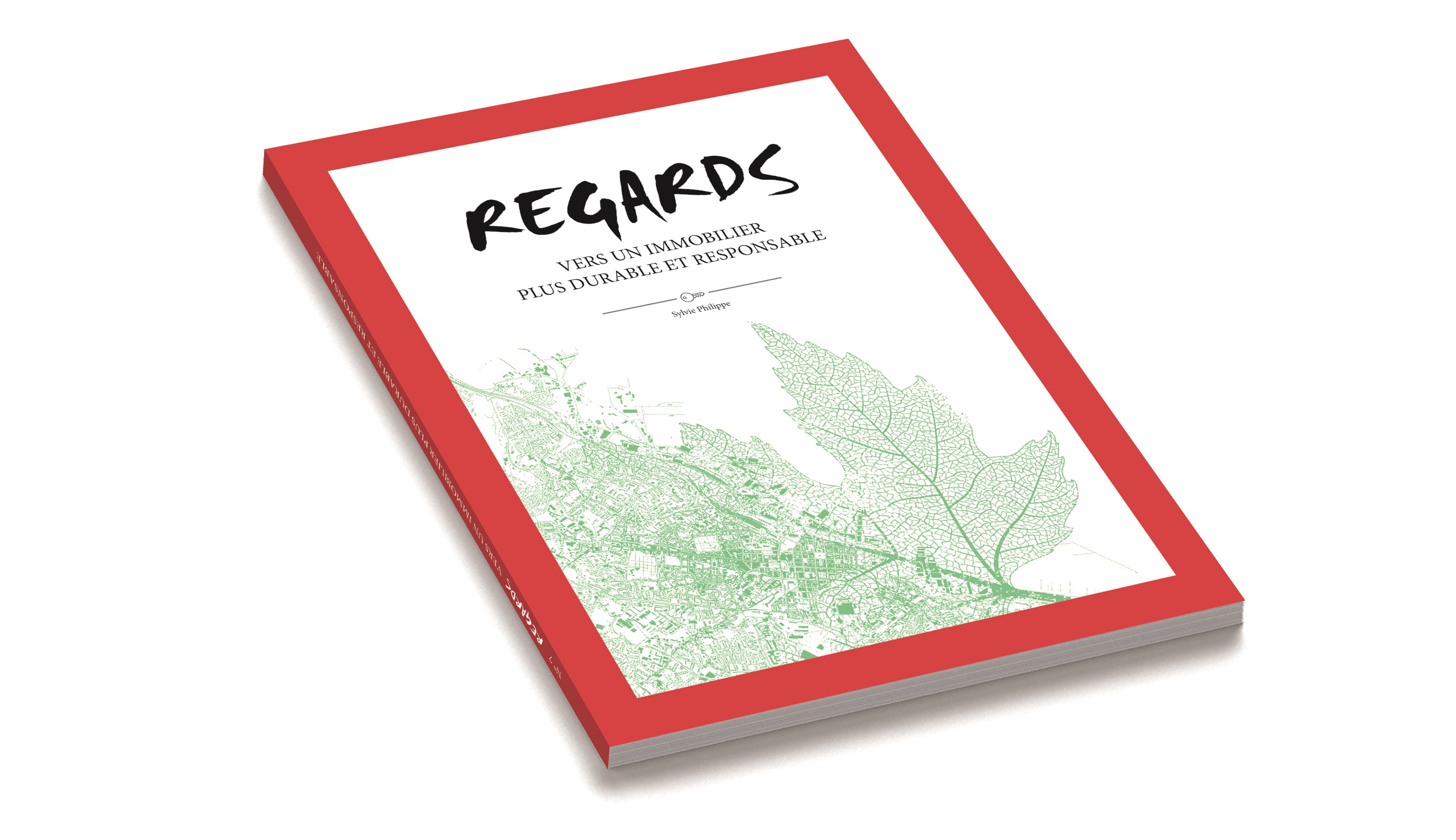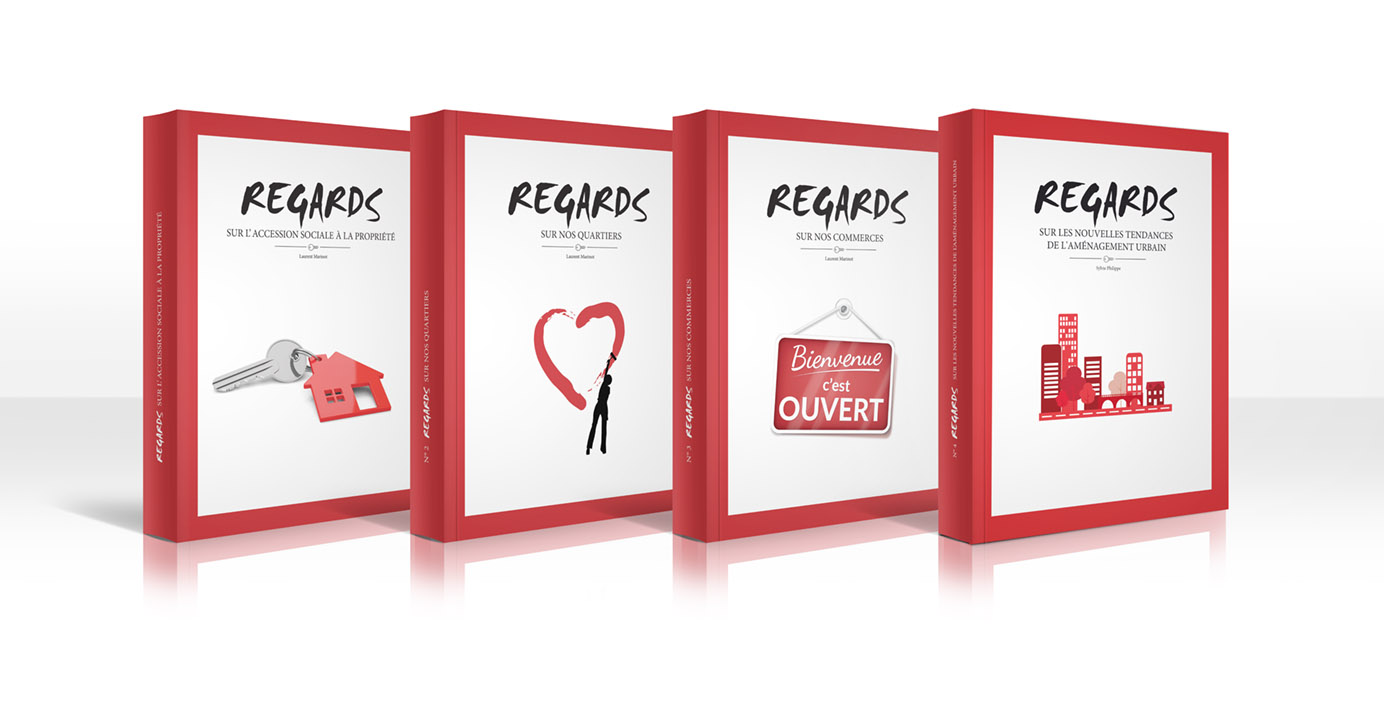Archives Mensuelles: juillet 2011
Comment la Région Picardie a réinventé son tourisme

La concertation entamée en 2009 a porté ses fruits. En adoptant, le 24 juin dernier, le Schéma Régional de Développement Durable du Tourisme et des Loisirs, le Conseil régional de Picardie a dessiné les contours d’un véritable modèle touristique picard : celui d’une stratégie co-construite, visant un développement touristique fort, qui profite à tous et préserve l’environnement.
Une politique partenariale
Le tourisme est un domaine transversal qui mobilise de nombreux partenaires stratégiques et opérationnels. Tous ont contribué à l’élaboration du SRDDTL depuis le début de la concertation, entamée en janvier 2009. Le SRDDTL a deux vocations :
- d’une part, construire une vision et définir une feuille de route claire pour les actions de développement touristique régional à moyen terme ;
- d’autre part, rassembler et fédérer les partenaires et acteurs autour de cette vision du développement touristique de la Picardie.
Le modèle picard
Le tourisme est une activité économique qui bénéficie d’une bonne dynamique en Picardie et qui contribue à l’attractivité régionale et à la qualité de vie des habitants. Le modèle de tourisme développé dans le SRDDTL est environnementalement et socialement soutenable. C’est-à-dire que, sans occulter sa fonction de développement économique, il se veut accessible à tous et respectueux de l’environnement, au sens large : préserver la faune et la flore, créer de l’emploi qualifié au niveau local, promouvoir les bonnes pratiques en matière de transport…
Un outil stratégique
Le SRDDTL sera la plateforme stratégique régionale sur laquelle s’appuieront les collectivités, organismes et acteurs œuvrant dans le domaine du tourisme. Il propose une vision renouvelée et pragmatique du développement touristique régional qui s’appuie sur des partenariats renforcés et sur un modèle de gouvernance exemplaire entre organismes de tourisme de Picardie.
Enfin, ce schéma fera l’objet d’un pilotage collectif permanent et d’évaluations régulières afin de l’ajuster aux évolutions contextuelles et structurelles et d’être en capacité d’anticiper les mutations rapides que connaît le secteur du tourisme.
Schéma Régional de Développement Durable du Tourisme et des Loisirs
L’emploi dans les associations : Bilan 2010 et conjoncture au premier trimestre 2011

Selon le tout dernier bilan annuel réalisé par l’association Recherches et Solidarités, le secteur associatif compte 1 815 000 salariés, il a augmenté de 1,8% par rapport à 2009 (le secteur privé de 0,3%) et il représente près de 10% de l’emploi privé. Cette année, ce bilan est complété par une approche conjoncturelle très fine, en glissement trimestriel, corrigé des variations saisonnières.
L’étude démontre que l’emploi associatif est en recul de -0,5%, au quatrième trimestre 2010, et de -0,4% au premier trimestre 2011. Les secteurs du sport, de la culture et de l’aide à domicile sont tout particulièrement concernés. Au plan régional, la Lorraine, Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon ont plus souffert que les autres régions.
L’année 2009 avait montré un bon maintien de l’emploi associatif dans un contexte plutôt morose. L’emploi dans les associations avait ensuite progressé en 2010 de 1,8% par rapport à 2009 alors que le secteur privé dans son ensemble régressait de 2,3%. Cette croissance de l’emploi associatif s’était confirmée en effet au premier semestre 2010 avec une analyse conjoncturelle qui fait état d’une augmentation des effectifs dans les associations de 1,6% au premier trimestre 2010 par rapport au 1er trimestre 2009, et de 1,4% pour le deuxième trimestre 2010.
Les dernières tendances à la baisse reflètent l’opinion des dirigeants d’associations. Dans l’enquête nationale menée en juin 2010 par Recherches et Solidarités, les dirigeants associatifs de certains secteurs étaient pessimistes sur l’avenir des emplois dans leurs structures. Ces associations semblaient avoir été relativement à l’abri les années passées comme le constate les deux études.
Grands ports maritimes : bilan de la réforme portuaire de 2008

Le rapport du groupe de travail du Sénat sur la réforme portuaire de 2008 a été publié le 6 juillet 2011. Il conclut que la réforme, effective depuis le 3 mai 2011, est insuffisante à enrayer le déclin des grands ports maritimes français. Il avance 15 propositions pour relancer leur activité. Ces propositions se structurent en quatre axes :
- l’élaboration d’une stratégie nationale des ports, qui allège la tutelle de l’État en décentralisant la gouvernance des grands ports maritimes au profit des collectivités du « bassin » portuaire et qui encourage les investissements portuaires à travers des sociétés de développement local,
- l’émergence d’un État coordonnateur et facilitateur, qui donne aux ports la maîtrise de la gestion de leur politique foncière et simplifie la réglementation en permettant notamment le recours aux procédures dérogatoires pour réaliser les projets des ports, de Réseau ferré de France et de Voies navigables de France. Le rapport préconise également la poursuite de la modernisation des services douaniers et le développement de zones logistiques,
- l’amélioration de la desserte de l’arrière-pays des ports et de la représentation des opérateurs terrestres dans la gouvernance portuaire,
- enfin, un renforcement de la promotion commerciale, une modernisation du dialogue social création de sociétés privées de manutentionnaires à capitaux publics sur le modèle allemand pour garantir une concurrence loyale dans les ports, notamment ceux de l’Outre-mer.
La contribution du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche (CRC-SPG) souligne que si les propositions du rapport sont en mesure de faire naître « un réel espoir » de développement des transports propres, leur financement sera « déterminant » pour assurer leur succès.