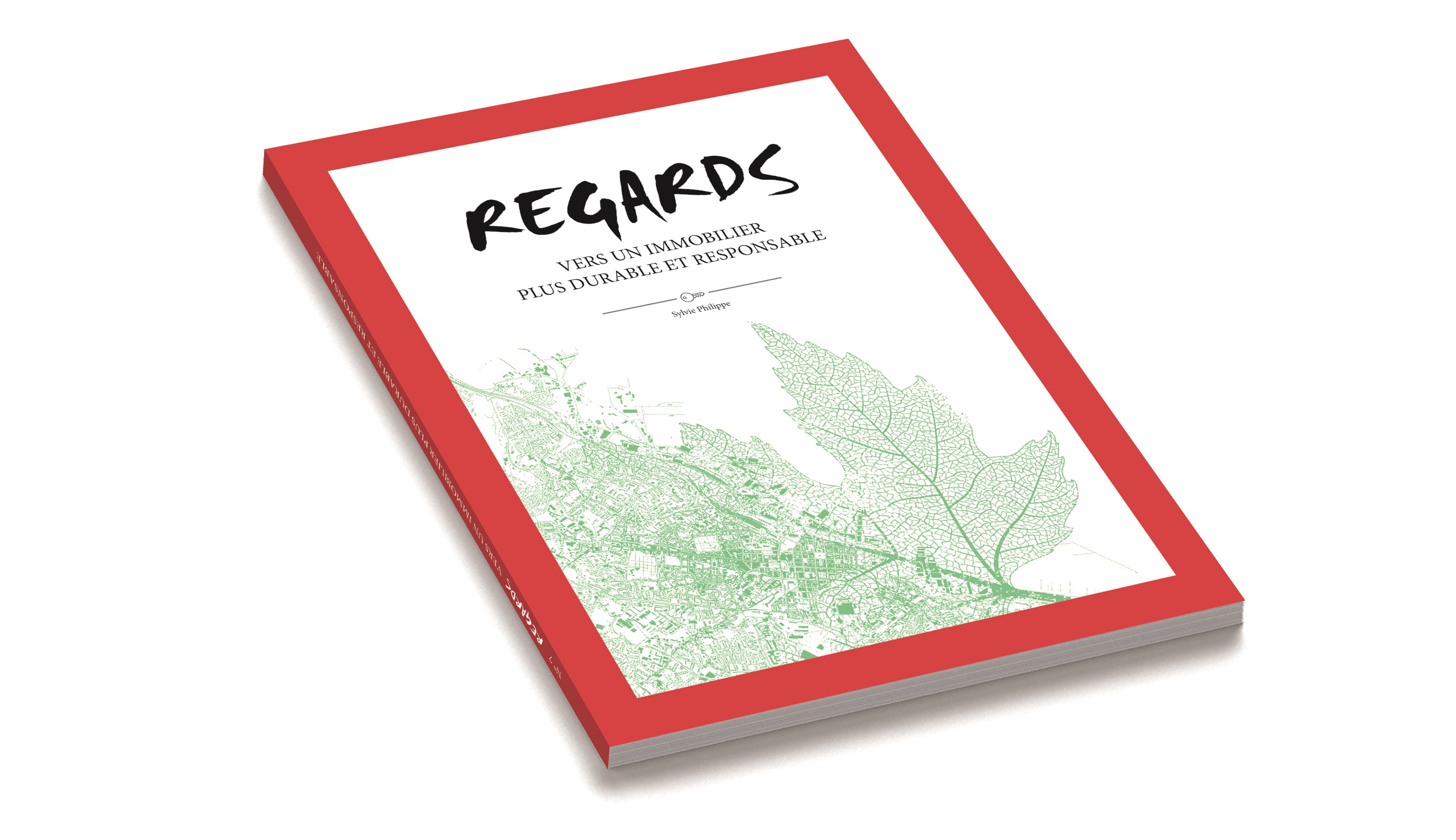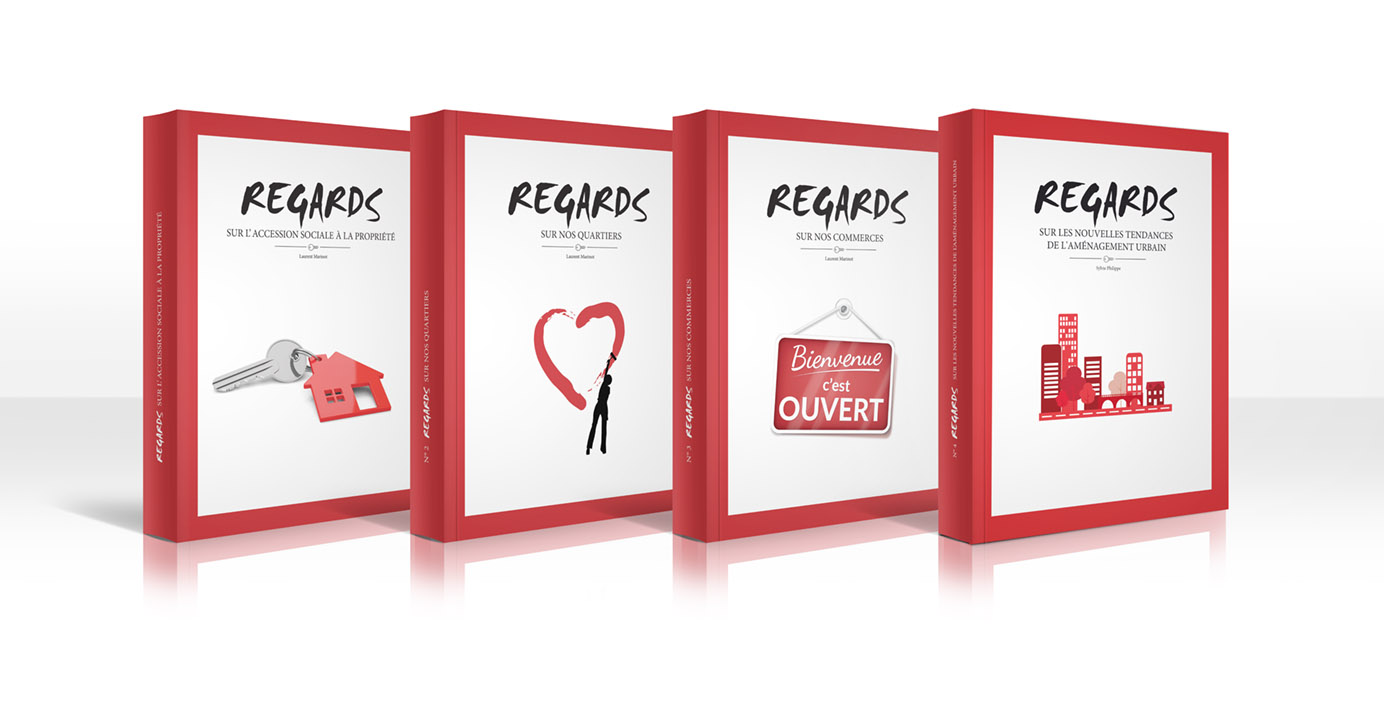Archives du blog
#Logement : la cohabitation entre 18-29 ans et leurs parents augmente ! @InseeFr
Source : Insee
Depuis les années 2000, nous remarquons une forte augmentation des jeunes de 18-29 ans qui habitent chez leurs parents ! Mais à quoi cela est réellement dû ?

Un départ progressif et une aide des parents, notamment pour les étudiants
L’autonomie résidentielle des jeunes adultes peut s’acquérir de façon progressive. Ainsi, près de 15 % des 18-24 ans qui habitent chez leurs parents n’y résident pas la totalité de l’année, mais plutôt durant les week-ends ou les vacances. Symétriquement, entre 18-24 ans, 5,2 % des jeunes adultes qui disposent d’un logement indépendant ne l’occupent pas toute l’année. À partir de 25 ans, la multi-résidence est plus rare pour ceux qui ont un logement indépendant ; elle reste relativement fréquente pour ceux qui vivent chez leurs parents, notamment quand ils sont étudiants.
Depuis 2000, la part des 18-29 ans habitant chez leurs parents augmente à nouveau
Depuis le début des années 2000, la proportion de jeunes adultes de 18 à 29 ans qui habitent chez leurs parents a augmenté. Cette hausse résulte principalement d’un effet de structure lié à l’accroissement de la part des chômeurs (+ 3,7 points, notamment après la crise de 2008) et des étudiants (+ 3,1 points) chez les jeunes adultes. Les taux de cohabitation demeurent nettement plus élevés pour les jeunes dans ces situations (58,5 % pour les chômeurs et 69,2 % pour les étudiants).
Précédemment, entre 1984 et 1996, le taux de cohabitation des jeunes adultes de 18 à 29 ans a progressé, essentiellement du fait de l’augmentation du nombre d’étudiants, à la suite de la seconde explosion scolaire et de l’accès massif de cette génération à l’enseignement supérieur. Au cours de cette période, la hausse de la cohabitation a cependant été freinée, à partir du début des années 1990, par l’extension des aides personnelles au logement qui ont facilité la décohabitation des étudiants. Les plus âgés ont subi les conséquences de la crise de 1992-1993 sur le marché du travail et la proportion de chômeurs parmi les 25-29 ans a augmenté. Entre 1996 et 2001, avec la reprise économique, le chômage a diminué. De ce fait, durant cette période, la proportion de jeunes adultes vivant chez leurs parents a reculé. Ce recul a été renforcé par la fin du service militaire décidée en 1996 : la très grande majorité des militaires du contingent vivaient une partie du temps chez leurs parents.
A lire aussi :
Logement : la hausse des prix de l’ancien se poursuit !
 Source : INSEE
Source : INSEE
Au second trimestre 2017, les prix des logements anciens sont en hausse +1,0 % par rapport au trimestre précédent (données provisoires corrigées des variations saisonnières). L’augmentation est nettement plus importante pour les appartements (+1,6 %) que pour les maisons (+0,6 %).
En Île-de-France, la hausse des prix de l’ancien se poursuit
Au deuxième trimestre 2017, les prix des logements anciens en Île-de-France augmentent de nouveau : +1,3 % par rapport au premier trimestre 2017, comme au trimestre précédent.
Sur un an, la hausse des prix s’intensifie : +3,9 % par rapport au même trimestre de l’année précédente, après +3,4 % début 2017 et +2,6 % fin 2016. Cette accélération provient d’une hausse plus prononcée des prix des appartements (+4,9 % sur un an, après +4,1 %), notamment des appartements parisiens dont les prix augmentent de 6,6 % en un an. La hausse des prix des maisons franciliennes est moins marquée et plus régulière (+1,9 % après +2,0 %).
Lire aussi :
Hausse des prix des travaux d’entretien-amélioration #logement @InseeFr #IPEA
Source : insee.fr
 Selon l’INSEE, l’organisme en charge de la collecte, l’analyse et la diffusion des informations sur l’économie et la société française, l’indice des prix des travaux d’entretien-amélioration des logements (IPEA) a connu un bond successif de 0.6% au premier trimestre 2017, après une quasi-stabilité au trimestre précédent (+0,1 %). C’est sa plus vive hausse depuis le premier trimestre 2012.
Selon l’INSEE, l’organisme en charge de la collecte, l’analyse et la diffusion des informations sur l’économie et la société française, l’indice des prix des travaux d’entretien-amélioration des logements (IPEA) a connu un bond successif de 0.6% au premier trimestre 2017, après une quasi-stabilité au trimestre précédent (+0,1 %). C’est sa plus vive hausse depuis le premier trimestre 2012.

La hausse des prix est forte dans les travaux de menuiserie, qu’il s’agisse de bois et PVC (+1,5 % après +0,3 %) ou de métallerie et serrurerie (+2,6 % après +0,4 %), essentiellement en raison de l’envolée des prix des matières premières métalliques et plastiques. Elle est moins marquée dans les travaux de plâtrerie (+0,8 % après +0,2 %) et encore plus modérée pour les autres types de travaux. Les prix sont stables dans les travaux de couverture et zinguerie.
Sur un an, les prix des travaux d’entretien-amélioration des logements augmentent davantage qu’au trimestre précédent (+1,1 % après +0,8 %). Les prix accélèrent dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie (+3,4 % après +3,0 %), de plâtrerie (+2,3 % après +1,7 %), de plomberie (+1,8 % après +1,5 %) et de menuiserie de bois et de PVC (+1,7 % après +0,8 %).
Au quatrième trimestre 2016, l’indice du coût de production dans les travaux spécialisés de construction de bâtiments anciens (ICP-43BTR) augmente plus modérément qu’au trimestre précédent (+0,3 % après +0,6 %). Sur un an, il croît de 1,6 %, un peu plus qu’au troisième trimestre (+1,4 %).
Lire aussi :
Le parc de logements en France au 1er janvier 2016 @InseeFr
Au 1er janvier 2016, la France hors Mayotte compte 35,4 millions de logements.
En France métropolitaine, 82 % des logements sont des résidences principales et 56 % des logements individuels. L’agglomération parisienne rassemble 16 % des résidences principales et les zones rurales 43 % des résidences secondaires. Dans les départements d’outre-mer, le parc de logement augmente plus vite qu’en métropole, de l’ordre de 2,5 % en moyenne par an depuis trente ans contre 1 % en métropole.
L’agglomération parisienne concentre 16 % des résidences principales
En 2016, 16 % des résidences principales se situent dans l’agglomération parisienne et 22 % en zone rurale (figure 4).
Les résidences secondaires ou logements occasionnels se situent bien plus souvent en zone rurale ou dans une petite unité urbaine (moins de 100 000 habitants) : dans quatre cas sur cinq contre seulement la moitié des résidences principales. Toutefois, la part du rural a diminué depuis trente ans (43 % en 2016 contre 51 % en 1986), alors que celle des petites unités urbaines s’est accrue (de 32 % à 39 %) avec l’urbanisation.
Enfin, la majorité des logements vacants se situent en zone rurale ou dans une petite unité urbaine (61 % en 2016). L’habitat individuel est d’autant plus fréquent que la commune est petite, et ce pour toutes les catégories de logement (résidence principale ou autre). Toutefois, quel que soit le type de commune, la part de l’habitat collectif est toujours plus élevée parmi les résidences secondaires et les logements vacants que parmi les résidences principales.
La reprise se diffuse dans la zone euro

En 2015, l’année a commencé par un coup de froid inattendu hors de la zone euro : l’activité américaine s’est à nouveau repliée, la croissance britannique a déçu et, surtout, les échanges mondiaux se sont fortement contractés. Pourtant, les économies avancées sortiraient rapidement de ce trou d’air. D’abord, parce que l’activité de la zone euro a conservé son rythme de croissance de fin d’année, accélérant un peu plus vivement qu’attendu en France, en Espagne et en Italie, et ce malgré un infléchissement en Allemagne. Ensuite, parce que les fondamentaux de la croissance des pays avancés semblent maintenant plus solides, comme l’atteste la bonne orientation du climat des affaires ; de ce fait, les économies anglo-saxonnes rebondiraient au deuxième trimestre. Enfin, parce que le commerce mondial se redresserait dès le printemps. Seul le ralentissement persistant des économies émergentes, notamment en Chine, au Brésil et en Russie, assombrit le tableau globalement dégagé des perspectives de croissance.
..en savoir plus…
>De Leblogdesinstitutionnels
Mon profil Google
Ma bio en résumé