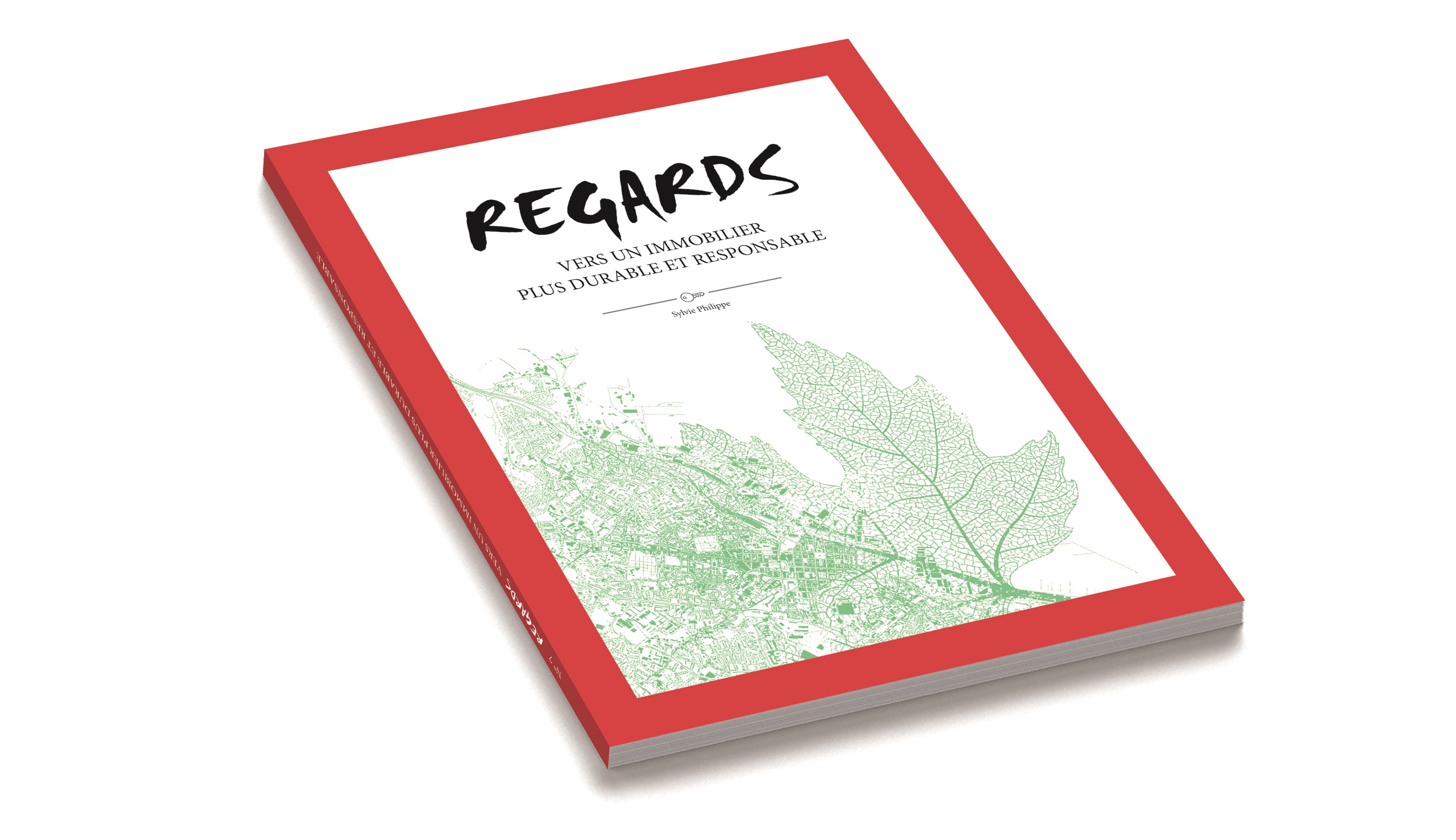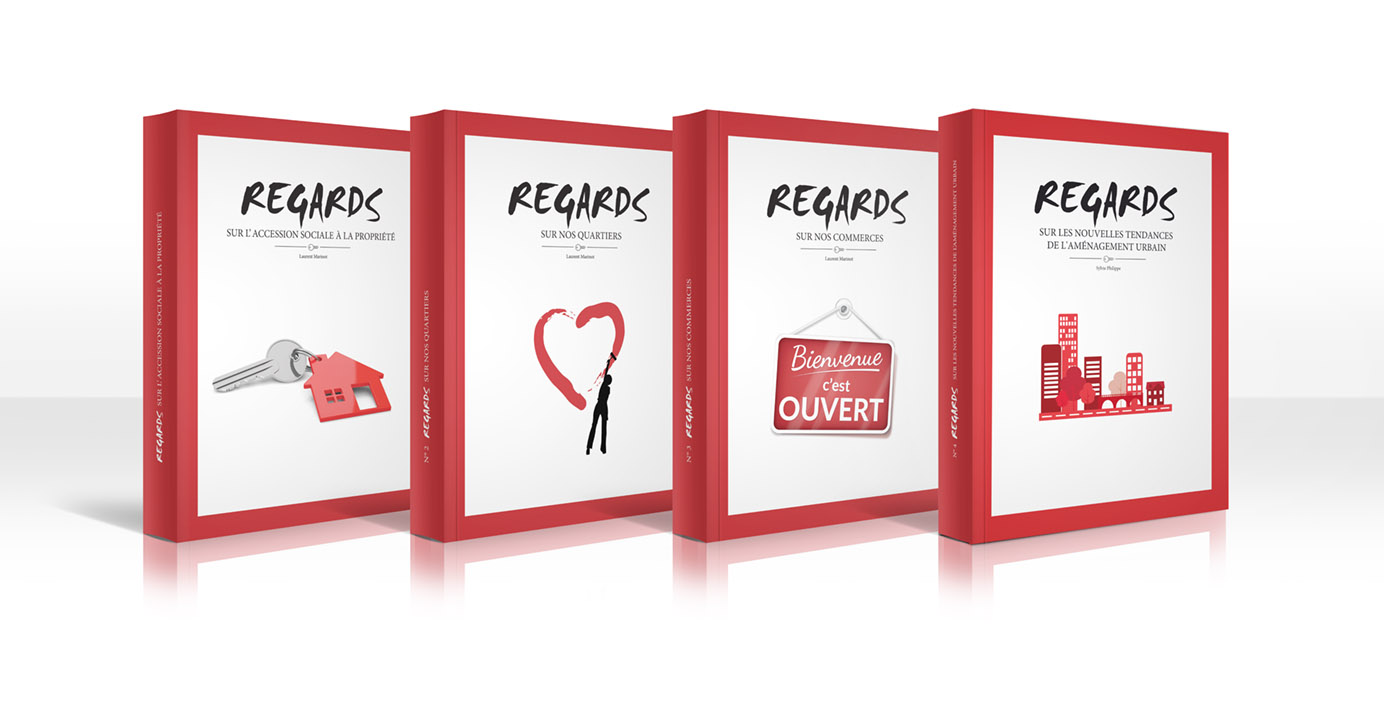Archives de Catégorie: RSE
4ème pilier de l’économie circulaire : le réemploi @Bouygues_C @MEL_Lille
 Source : blog bouygues construction
Source : blog bouygues construction
Le réemploi, quatrième pilier de l’économie circulaire
Réemployer les matériaux issus de rénovation ou de déconstruction, l’idée fait son chemin. Il faut dire qu’elle a de quoi séduire. Car en réactivant cette pratique séculaire, on gagne sur tous les plans : nouvelles filières de valorisation, matériaux à faible coût, amélioration du bilan carbone des opérations… La liste est longue. Reste à lever les freins.
Opération significative, mais cette fois-ci à l’échelle d’un quartier : celle de la Maillerie, dans la métropole lilloise.
Cet ancien site logistique des Trois Suisses va être reconverti en un quartier multiusage. Là aussi, on expérimente le réemploi. « Ce type de projet – un nouveau quartier sur une friche industrielle – est idéal pour éviter de sortir des déchets et optimiser le réemploi », explique Thierry Juif. Ainsi les bétons de déconstruction sont réemployés en granulats recyclés pour fabriquer du béton. Un classique. Moins commun en revanche pour Thierry Juif, la nouvelle vie des parquets en chêne massif. « Ils ont été en partie revendus à un fabricant. Celui-ci va les découper dans l’épaisseur pour réaliser la couche de finition de parquets contrecollés. Avec une lame il va en faire cinq ! »
Mieux faire respirer la ville : l’agriculture urbaine pourrait-elle être une solution ? @nexity #Enviesdeville
 Source : Envies de ville by Nexity
Source : Envies de ville by Nexity
Alors que nos villes sont confrontées à de multiples défis environnementaux et que les citadins expriment de plus en plus leur souhait d’accéder à une alimentation locale et durable, l’agriculture urbaine se développe à toute vitesse. Quelle est cette « nouvelle » forme d’agriculture ? Comment s’intègre-t-elle dans l’aire urbaine ? Et quels sont ses bénéfices ?
L’agriculture urbaine : de quoi parle-t-on ?
L’agriculture urbaine regroupe différentes pratiques visant à faire pousser des fruits, des légumes et autres végétaux, au sein des villes. Autrement dit, au sommet des immeubles, dans des espaces de verdure, dans des containers ou dans des fermes verticales, par exemple. L’agriculture urbaine peut également constituer une activité d’élevage. Aux Pays-Bas par exemple, au milieu du port de Rotterdam, existe ainsi depuis 2019 la première ferme urbaine et flottante à l’énergie solaire, avec ses vaches laitières.
Quels bénéfices pour le consommateur et la collectivité ?
Une activité créatrice de cohésion sociale
Au sein des villes, les fermes urbaines et même les simples lopins de terre cultivés par les habitants d’un même quartier, créent un lien social fort. Les jardins d’insertion notamment donnent une chance aux personnes exclues du monde du travail de retrouver un emploi.
Une activité créatrice d’attractivité économique et environnementale
Pour les modèles non associatifs, la capacité dans le temps à atteindre un équilibre économique voire même à dégager une rentabilité est souvent sujette à débat. Le coût initial des installations en milieu urbain est élevé et rarement porté par l’utilisateur agricole lui-même. Aujourd’hui, ce sont souvent les co-bénéfices environnementaux, sociaux et d’attractivité qui poussent les investisseurs à soutenir ces formes émergentes. Les structures du secteur se diversifient pour pérenniser leurs exploitations : animations, ateliers, vente de produits transformés à haute valeur ajoutée, restauration, services aux entreprises… L’agriculture urbaine cherche encore son modèle économique
Nouvelle-Aquitaine: ECOBIOSE, la biodiversité a son comité scientifique @RegiondeFrance @NvelleAquitaine
Source : Régions France
Consciente des enjeux en matière de biodiversité, la Région Nouvelle-Aquitaine a créé Ecobiose, un comité scientifique interdisciplinaire, regroupant 150 scientifiques de Nouvelle-Aquitaine. Les travaux d’Ecobiose visent à évaluer les rôles de la biodiversité dans le fonctionnement des sociétés humaines en Nouvelle-Aquitaine.
La mission d’Ecobiose : évaluer l’état et comprendre le rôle de la biodiversité
Début 2017, et c’est inédit, la Région Nouvelle-Aquitaine a initié la mise en place d’un comité scientifique régional de la biodiversité, Ecobiose. Avec environ 150 scientifiques de Nouvelle-Aquitaine, spécialistes en sciences de l’écologie et en sciences humaines et sociales, elle a pour objectif de dresser un état des lieux des connaissances scientifiques sur les rôles de la Biodiversité à la fois dans le fonctionnement des écosystèmes, mais aussi dans celui des sociétés humaines qui habitent et exploitent les ressources naturelles de ces écosystèmes.
Sont ainsi analysés les secteurs socio-économiques dont l’activité repose sur l’exploitation des ressources naturelles, comme l’agriculture ou la sylviculture, ou les aspects socio-culturels (chasse, écotourisme, protection des espèces et des paysages).
Ecobiose évalue l’état de la biodiversité, les relations entre biodiversité et fourniture de services, et les conséquences de son érosion sur tous les domaines de la société humaine (agriculture, filière Bois, santé …).
Un rapport complet en octobre 2019
Quels enjeux pour les communes et les élus les zones à « faibles émissions » ? @nexity #Enviesdeville
 Source : Envies de ville by Nexity
Source : Envies de ville by Nexity
En juin dernier, l’Assemblée nationale a adopté la loi d’orientation des mobilités (LOM). Elle contient une série de mesures ambitieuses sur la mobilité en elle-même et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors que la dernière canicule a nécessité de mettre en place la circulation différenciée, intéressons-nous au déploiement futur des ZFE, les zones à « faibles émissions », prévu par cette loi. Pourquoi un tel dispositif ? Quel est son fonctionnement ? Quelles communes et quels véhicules sont concernés ?
Quid des villes moyennes ?
Dans les villes moyennes, où les citoyens sont très dépendants de leur véhicule, les mesures de restrictions sont difficiles à faire accepter. Même si cela ne suffit pas toujours, des aides financières cumulables existent et représentent une solution attractive. Le bonus écologique ou la prime à la conversion par exemple, peuvent permettre de réduire considérablement la facture. Ainsi, un foyer non-imposable peut bénéficier d’une prime de 5000 € pour une voiture hybride rechargeable ou électrique, et jusqu’à 4000 € pour une voiture thermique. Dans un second temps, la collectivité a la possibilité de mettre en place des systèmes incitatifs pour encourager le covoiturage et pour, d’une manière générale, laisser sa voiture au garage.
Par ailleurs, les navettes autonomes deviendront peu à peu une réalité partout.
Vignette Crit’Air : ce qui a changé depuis 1er juillet 2019 @paris
 Source : Paris
Source : Paris
Nouvelle étape dans le programme de lutte contre la pollution instauré par la Ville depuis le 15 janvier 2017, lorsque Paris devenait alors la première ZFE (zone à faibles émissions) de France. Depuis le 1er juillet 2019, la circulation dans Paris intra-muros des véhicules autres que Crit’Air 1,2,3 est restreinte. Les véhicules légers et véhicules utilitaires légers portant la vignette Crit’Air 4 ou Crit’Air 5 ne peuvent plus circuler à Paris de 8h à 20h, du lundi au vendredi. Les poids lourds et autocars portant la vignette Crit’Air 4 ou Crit’Air 5 ne peuvent plus circuler à Paris de 8h à 20h, 7 jours sur 7.
Autre nouveauté à partir du 1er juillet : pour le périphérique et les bois de Vincennes et de Boulogne, la circulation est retreinte pour les véhicules non classés et Crit’Air 5. Cette décision de la Ville est prise en cohérence avec l’engagement de la Métropole du Grand Paris. Ainsi, de nombreuses communes incluses dans le périmètre de l’A86 interdisent également les véhicules non classés et Crit’Air 5 sur leur territoire depuis le 1er juillet 2019.
Quand ai-je le droit de circuler dans Paris intramuros selon ma vignette Crit’Air ?