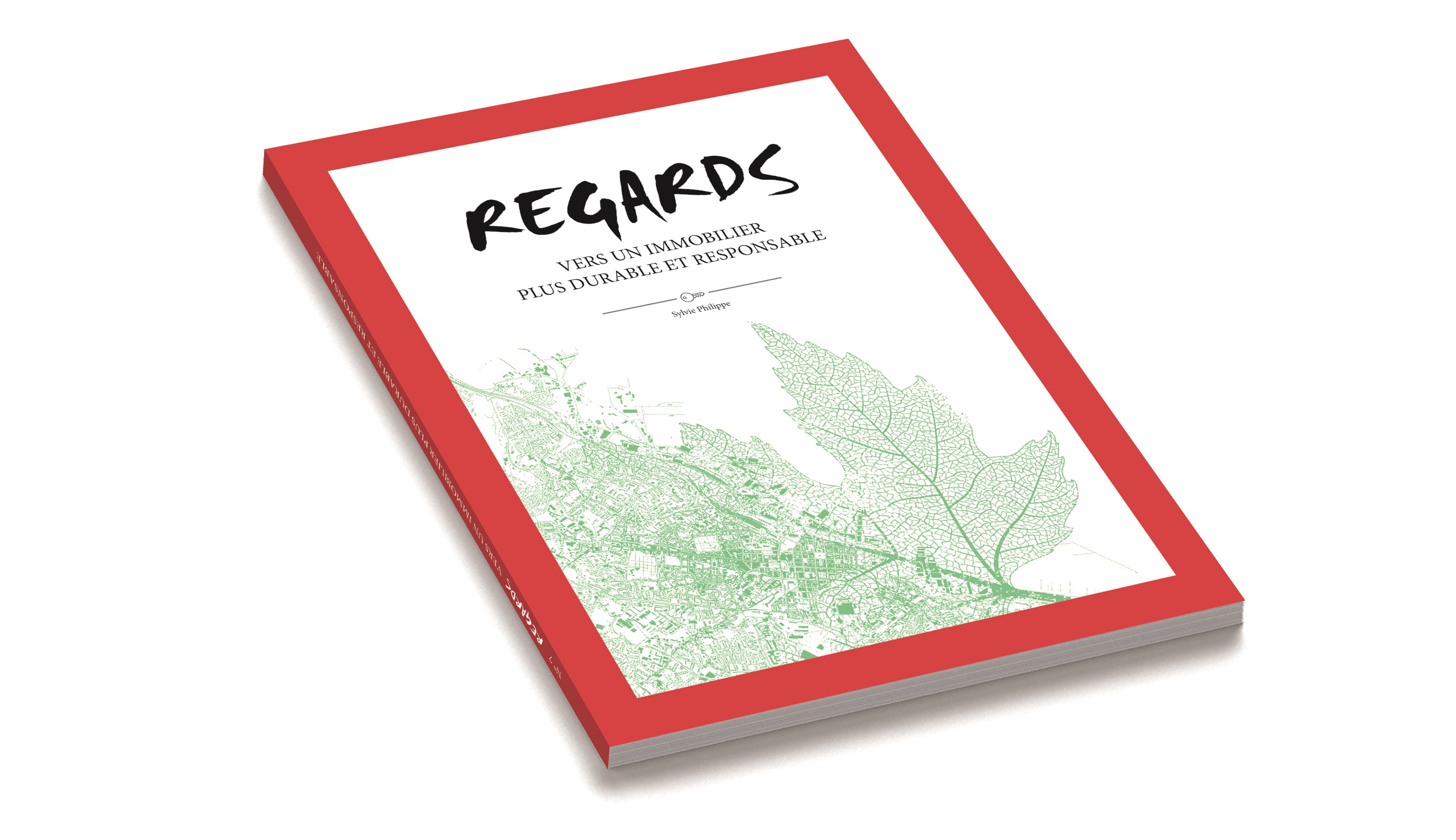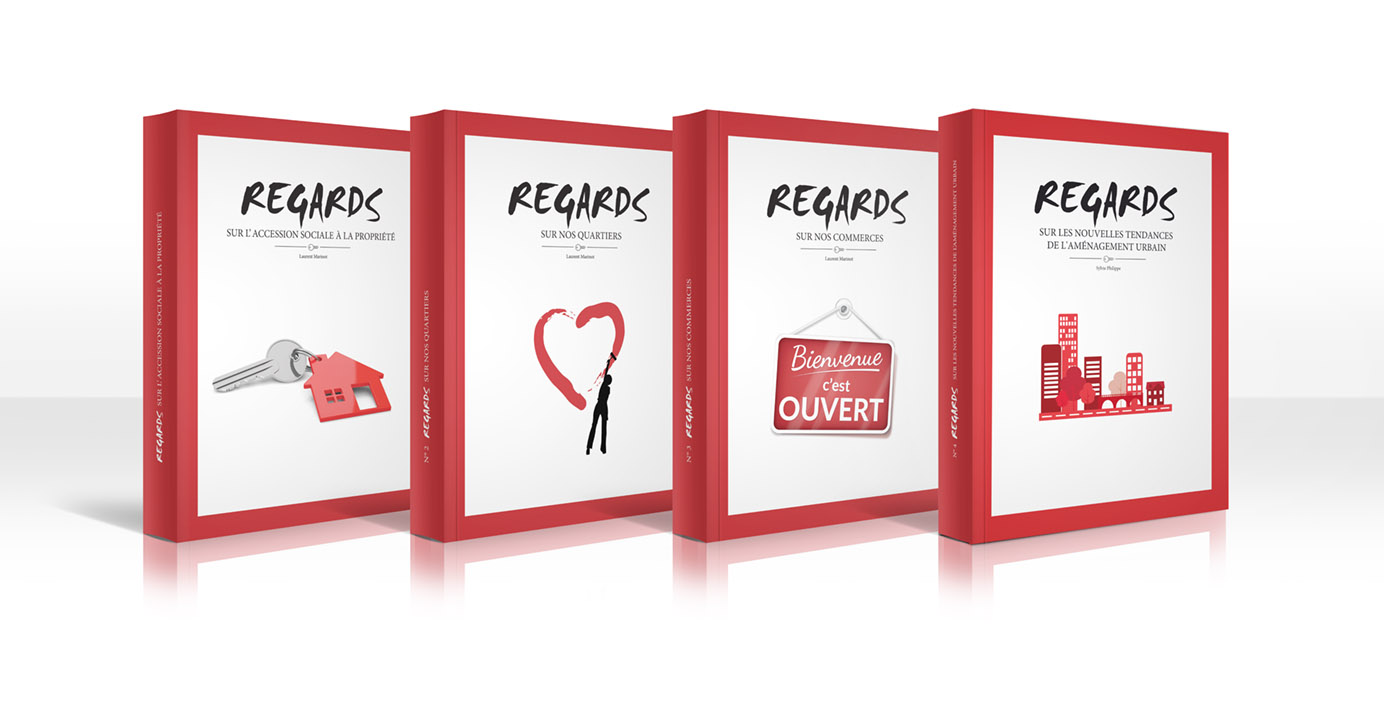Archives Mensuelles: Mai 2016
Réforme des marchés publics: quels changements dans le décret du 25 mars 2016 ?

Après l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, viennent d’être publiés ses très attendus décrets d’application, dont l’un s’applique à tous les marchés, y compris de partenariat, à l’exception des marchés publics de défense et de sécurité qui sont régis par l’autre décret. Les deux décrets du 25 mars 2016, tout comme l’ordonnance, sont entrés en vigueur dès le 1er avril 2016.
Ainsi, tous les marchés « pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication » depuis le 1er avril 2016 sont soumis à cette nouvelle règlementation.
Pour mémoire, ces dispositions ont pour objet, d’une part, de transposer les nouvelles directives « marchés » n° 2014/24 et 2014/25 du 26 février 2014 et, d’autre part, de rationnaliser la commande publique à travers la création « d’un corpus unique » de textes régissant l’ensemble des marchés publics. Ainsi, pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, anciennement soumis au Code des marchés publics comme à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés publics passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, relèvent désormais des mêmes textes.
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics, est porteur d’évolutions et d’innovations dont les principales sont ici évoquées.
1. Identification renforcée des besoins
Les acheteurs peuvent désormais expressément recourir, préalablement à toute consultation, à des échanges avec les opérateurs économiques ou encore à la réalisation d’une étude de marché. Ils sont toutefois tenus de ne pas « fausser la concurrence », ni porter atteinte aux principes de la commande publique. Inversement, ils sont tenus de « prendre les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée » (art. 4 et 5).
Si l’ordonnance de 2015 a par ailleurs généralisé le principe de l’allotissement à tous les marchés publics et imposé de justifier le recours à un marché global, ce qui impacte fortement les procédures des acheteurs relevant jusqu’alors des dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005, le décret précise que cette justification doit figurer dans les documents de la consultation (art. 12).
2. Dématérialisation et transparence
A compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs, tous sont tenus de dématérialiser leurs procédures de passation et d’effectuer au moyen de communications électroniques tous leurs échanges d’informations (art. 38 à 42). A cette fin, d’une part, les documents de la consultation devront être gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur le profil d’acheteur (art. 107) et, d’autre part, toutes les communications et tous les échanges d’informations devront être effectués par des moyens de communications électroniques.
Toutefois, ce principe connaît de nombreuses exceptions.
En outre, le décret impose aux acheteurs, au plus tard le 1er octobre 2018, de publier, sur leurs profils d’acheteur, un certain nombre de données essentielles concernant non seulement l’attribution mais également les modifications apportées à leurs marchés publics, et ce quel que soit leur montant. Echappent toutefois à cette obligation de publication les informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.
3. Sélection des candidats, examen des offres et prise en compte d’objectifs de développement durable
Les modalités de sélection des candidatures et de jugement des offres ont été considérablement assouplies. Désormais, l’acheteur aura la possibilité de vérifier les capacités des candidats à tout moment de la procédure, jusqu’à l’attribution du marché public (article 55), et d’examiner les offres avant les candidatures et ainsi de vérifier uniquement la recevabilité de la candidature accompagnant l’offre économiquement la plus avantageuse (article 58). La faculté de régulariser les offres lui est également offerte, sous certaines conditions (article 59).
S’agissant par ailleurs des offres anormalement basses, l’appréciation du caractère anormalement bas peut désormais se faire au regard les obligations applicables dans les domaines du droit de l’environnement, du droit social ou encore du droit du travail (article 60).
Le décret accroît plus largement les possibilités de prise en compte d’objectifs de développement durable, tant dans la définition des besoins à travers les spécifications techniques et labels (art. 4 à 11), que dans les critères de sélection des candidatures et de jugement des offres (art. 44 et suivants) ou encore dans les conditions d’exécution du marché. En particulier, est introduite la faculté de prendre en compte le coût de cycle de vie, notion avec laquelle il reviendra aux acheteurs de se familiariser (art.62 et 63).
1ère nationale : la Normandie prend la gouvernance des Intercités
Première nationale : la Région prend la gouvernance des trains Intercités

Hervé Morin, Président de la Région Normandie a signé avec le Premier ministre, cet après-midi, au Mont-Saint-Michel, une convention de transfert à la Région Normandie de cinq lignes dites « Train d’Equilibre du Territoire » (TET) : Paris-Caen-Cherbourg/Trouville-Deauville, Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Granville, Paris-Evreux-Serquigny et Caen-Le Mans-Tours.
Cette première convention nationale entre l’Etat et une Région sur les TET sera accompagnée d’un engagement de l’Etat à renouveler, d’ici 2019 ou 2020 au plus tard, les matériels roulants sur deux de ces lignes : Paris-Caen-Cherbourg / Trouville-Deauville et Paris-Rouen-Le Havre.
Fruit de quatre mois de négociation avec le gouvernement, Hervé Morin a obtenu 720 millions d’euros pour le renouvellement par l’Etat du matériel roulant des deux principales lignes normandes.
Une fois les premières rames livrées et les lignes modernisées, la Région deviendra, à l’instar des TER, autorité organisatrice des lignes normandes TET, dites lignes Intercités. La Région prendra ainsi la responsabilité des horaires, du cadencement et de la gestion des équipements.
La Normandie fait œuvre de pionnière en devenant la première Région française à assumer une compétence particulièrement lourde et complexe en lieu et place de l’Etat…en savoir plus…
Qu’est-ce qu’un bâtiment passif ? Par le Blog Vilogia
Qu’est-ce qu’un bâtiment passif ?
2020 sera l’ère des bâtiments à énergie positive. D’ici là, les bâtiments passifs deviendront la norme pour les constructions neuves. Définition, avantages, et différences entre bâtiment passif, BBC et à énergie positive.
Le concept de bâtiment passif (« Bpas ») a été développé à partir des années 1970, pour produire des bâtiments économes en énergie et au confort d’usage et d’habitabilité élevé.
Aujourd’hui, le logement passif repose sur : un concept de construction très basse consommation, basé sur l’utilisation de l’apport de chaleur du soleil, une très forte isolation des murs et des fenêtres, l’absence de ponts thermiques, une grande étanchéité à l’air et le contrôle de la ventilation.
Trois critères permettent de déterminer si un bâtiment neuf peut obtenir la labellisation allemande de performance énergétique « Passiv’Haus » :
- Les besoins en chauffage doivent être inférieurs à 15 kWh/m2/an ou puissance de chauffe inférieure à 10 W/m2 ;
- L’étanchéité de l’enveloppe doit être inférieure ou égale à 0,6 vol/h à 50 Pascal. Cette étanchéité est indispensable pour assurer un bon fonctionnement du système mécanique de ventilation et utiliser une ventilation double-flux avec récupération de chaleur ;
- Les besoins en énergie primaire totale (chauffage, ventilation, éclairage, eau chaude sanitaire, auxiliaires et équipements électrodomestiques) doivent être inférieurs 120kWh/m2/an.
En France, l’association La Maison Passive France se charge de certifier les logements passifs répondant à ces critères.
Quels avantages à vivre dans un logement passif ?
Une température homogène dans chaque pièce quelle que soit la saison ;
Une qualité d’air nettement supérieure à celle d’une construction standard ;
Aucune sensation de froid au niveau des ouvertures (fenêtre, portes, …) ;

 Source :
Source :