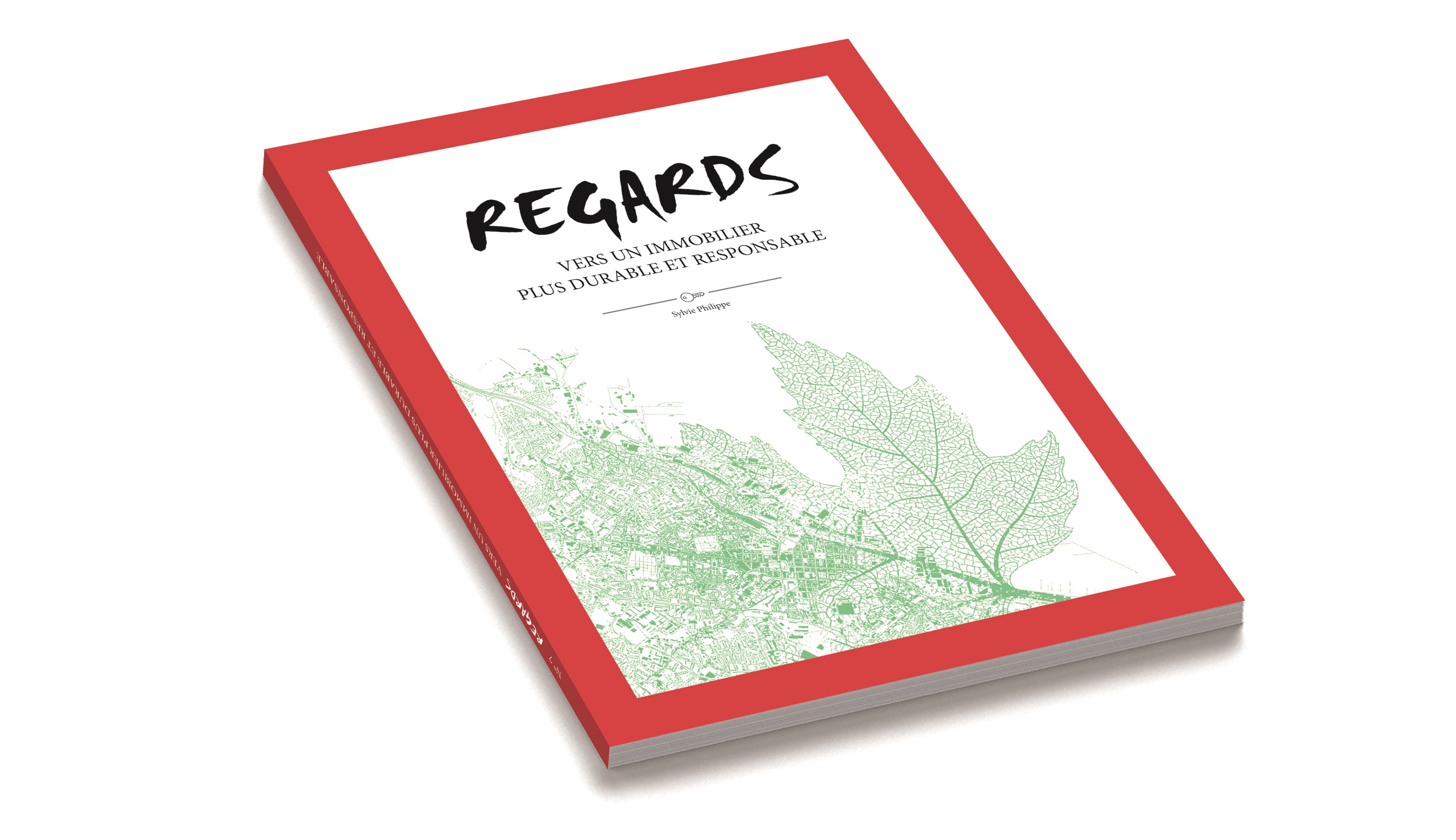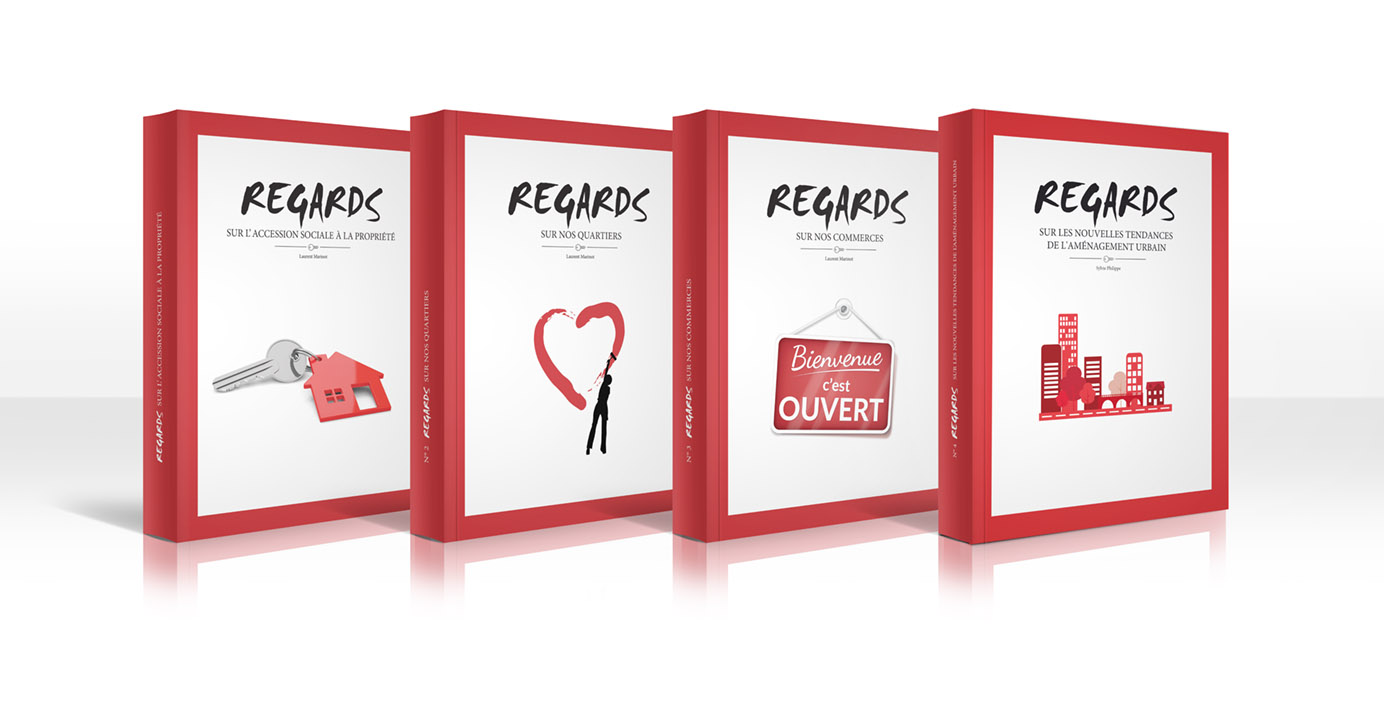Archives Mensuelles: juin 2011
Le numérique peut-il aider à donner une autre image de la Culture ?

vendredi 24 juin dès 8h30 à l’Hôtel de Ville
Le numérique peut-il aider à donner une autre image de la Culture ? A porter un regard différent sur le patrimoine historique de nos villes ? A mieux partager, finalement, notre savoir collectif ? Les différentes technologies (la 3D, la réalité augmentée, les codes QR, les serious games et les réseaux sociaux) et leurs usages sur smartphones font aujourd’hui l’objet d’expérimentations culturelles pour susciter l’intérêt du public et observer leurs réactions. Ce colloque organisé dans le cadre du Festival de la vie et de la ville numérique, Futur en Seine, réunit les représentants des sites pilotes du projet européen Apollon, de la Commission européenne, des collectivités locales et des entreprises innovantes, pour faire un point sur l’état d’avancement des projets numériques culturels.
Les différentes technologies (la 3D, la réalité augmentée, les codes QR, les serious games et les réseaux sociaux) et leurs usages sur smartphones font aujourd’hui l’objet d’expérimentations culturelles pour susciter l’intérêt du public et observer leurs réactions.
La découverte d’une page de l’Histoire d’Issy-les-Moulineaux via smartphone, plan 3D, code QR et cross media, la couverture par des web reporters de la restauration de la Bibliothèque centrale de Manchester ou la création d’un serious game pour intéresser les jeunes visiteurs à parcourir les galeries du Musée d’Art contemporain d’Anvers servent de décors à une expérimentation européenne, menée actuellement dans le cadre du projet Apollon (Advanced Pilots of Living Labs Operating in Networks). Son but est de tester différentes technologies, basées sur la 3D, les codes QR, la réalité augmentée, le serious game et les réseaux sociaux, sur différents usages culturels pour susciter l’intérêt du public et observer leurs réactions. Mais au-delà de ces exemples, de nombreuses collectivités et organismes culturels se sont déjà lancés sur cette voie.
Ce colloque organisé dans le cadre du Festival de la vie et de la ville numérique, Futur en Seine, réunit les représentants des sites pilotes du projet européen Apollon, de la Commission européenne, des collectivités locales et des entreprises innovantes, pour faire un point sur l’état d’avancement des projets numériques culturels.
Une Spl pour les thermes de Balaruc-les-Bains
C’est une Société publique locale (Spl) qui a été choisie pour gérer l’exploitation thermale de Balaruc-les-Bains à partir de 2012. Un nouvel établissement thermal, future locomotive économique de la commune et de l’ensemble du Bassin de Thau, est en cours de réalisation.

Gérés depuis des décennies par une régie municipale, l’exploitation des Thermes de Balaruc-les-Bains va prendre la forme d’une Spl. « Cette évolution, qui a reçu l’adhésion d’une large majorité du personnel, est devenue une nécessité pour faire face aux impératifs de gestion. Le thermalisme balarucois s’est fortement renforcé depuis près de 3 ans », explique Gérard Canovas, maire de Balaruc-les-Bains. De 37 000 curistes par an en 2007, la ville est en effet passée à près de 40 400 avec le développement de soins en phlébologie qui complète la rhumatologie. La structure réalise ainsi désormais un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros, employant pas moins de 380 salariés en CDI, CDD et CDII (soit 275 équivalents temps plein). « La forme juridique d’une régie, avec sa comptabilité publique, n’était plus adaptée, poursuit Gérard Canovas. Nous avons d’abord pensé à créer une Sem, mais le législateur a ouvert la voie vers une formule encore plus pertinente en mettant en place, en mai 2010, les Sociétés publiques locales ».
AMÉNAGEMENT, MOBILITÉ, ATTRACTIVITÉ : COMMENT FAIRE EXISTER DES TERRITOIRES PERTINENTS
En permettant la création de pôles métropolitains, la réforme territoriale offre aux territoires de nouveaux modèles de développement. Moins contraignants que les métropoles proprement dites, les pôles métropolitains laissent les territoires libres de s’organiser comme ils l’entendent et de choisir les domaines de convergence appropriés à leurs réalités et à leurs objectifs.
La communication en la matière n’a pas pour objet de faire exister une nouvelle strate administrative, peut être même pas d’expliquer un concept à vocation technique. Elle a pour fonction, d’une part, de rendre lisibles et appréhendables par le grand public des territoires pertinents aux regards des usages, bassins de vie et territoires de projet. Elle constitue, d’autre part, un levier de gouvernance destiné à mobiliser les acteurs autour des dynamiques métropolitaines.
La communication doit donc être intégrée tout au long du processus à la fois par les acteurs de première ligne comme les collectivités locales, les bailleurs sociaux ou les organismes de transport, et les acteurs du back office comme les agences d’urbanisme, les agences de développement ou les sociétés d’aménagement.