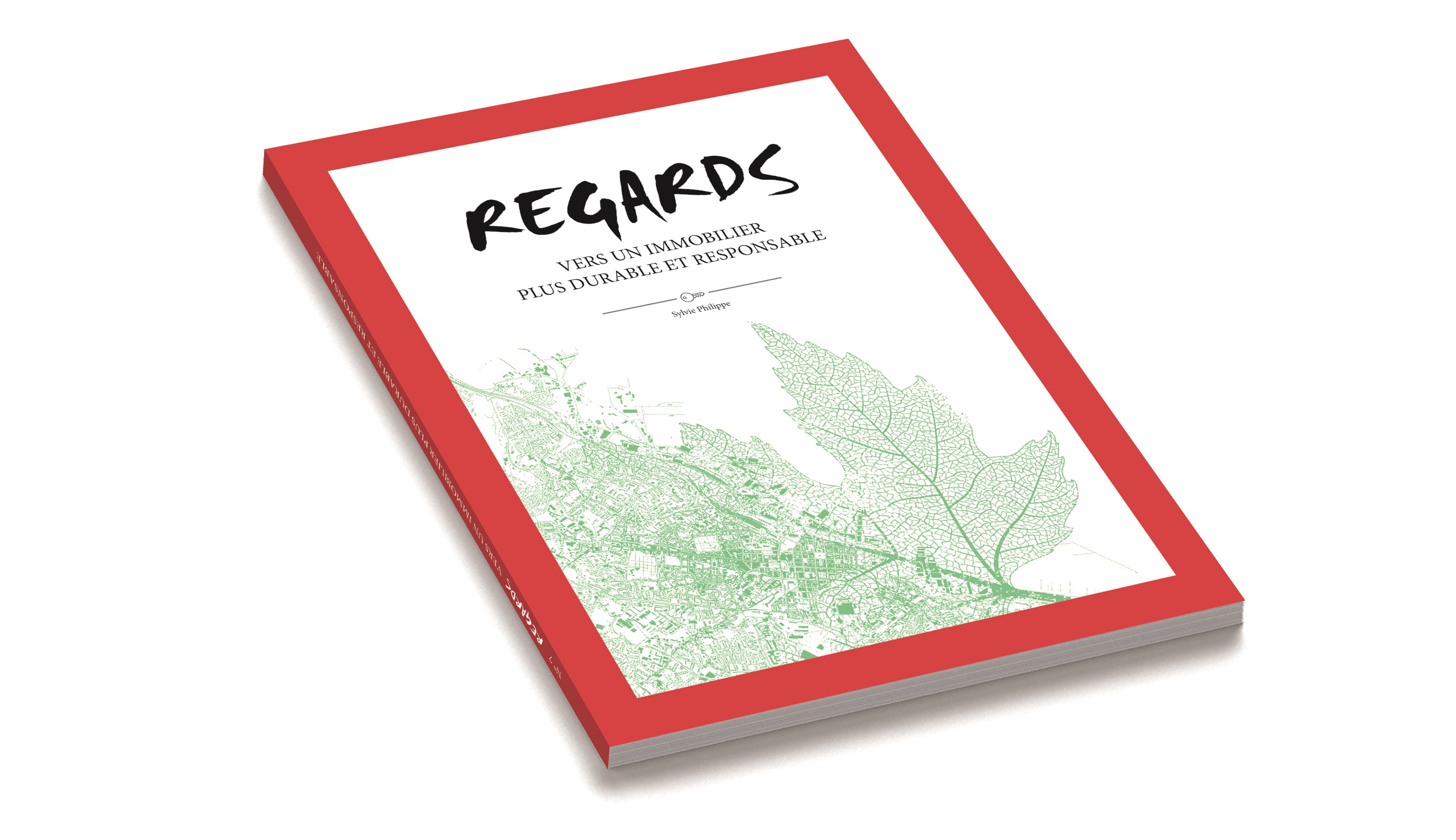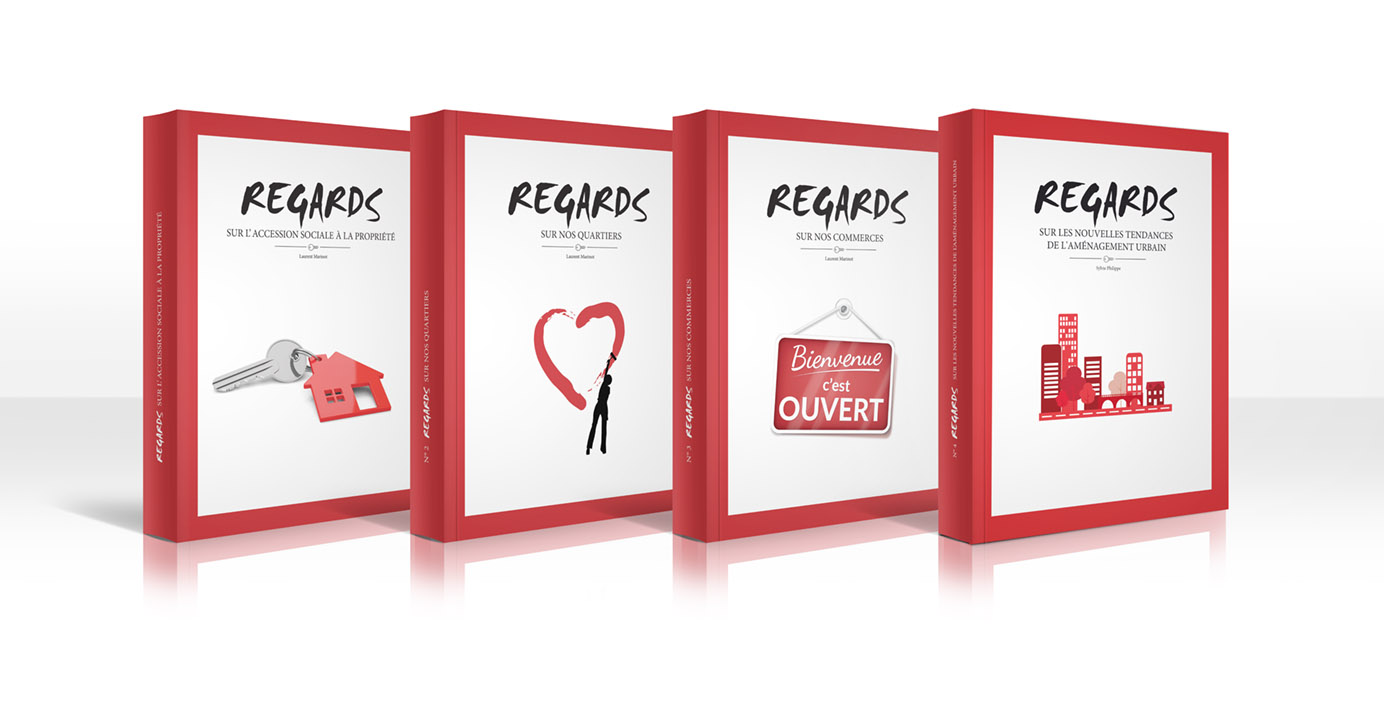Archives du blog
Comment repenser nos modèles de sociétés et nos politiques de logement ? @_GEFILS
Publié par Alexandra Poloce

> Pour en savoir plus sur GEFILS et/ou vous abonner à l’EHebdo, rendez-vous sur www.gefils.fr, ou contactez schoepfer.a@gefils.fr
Après une année 2018 assez dense et particulièrement agitée en France, on ne peut qu’accueillir avec soulagement cette nouvelle année en espérant qu’elle soit plus apaisée et constructive que sa précédente, et notamment en matière de logement.
Marqué par les lois de finances, la loi ELAN, les coupes dans les allocations logement (APL), les drames liés à l’habitat indigne (etc.), le secteur du logement aura connu une année 2018 riche en actualité et un bouleversement majeur et historique de son modèle et de son financement associé.
Un bouleversement majeur qui, comme nous le rappelle le Courrier des Maires, en plus d’aller à « contre-courant » de certains de nos voisins européens qui réinvestissement massivement dans le logement social (voir l’entretien avec L. Ghekière dans e-hebdo), n’apporte aucune réponse à de nombreuses villes moyennes des « zones détendues » et va contraindre les acteurs du logement social à se « réinventer » .
La digestion de cette loi et la mise en place opérationnelle des nombreuses évolutions qu’elle introduit devrait donc occuper une grande partie de l’activité des acteurs du logement en 2019 et devrait nous réserver encore quelques surprises notamment en ce qui concerne le paysage du secteur (concentration des bailleurs, évolution de leur mission, etc.), son dynamisme (réforme des aides au logement, des aides fiscales, de la TVA, baisse de la construction, etc.) et modifier peut-être les choix d’accès au crédit !
Au-delà de la loi ELAN, gageons que 2019 soit également marquée – comme nous le soulignons régulièrement dans ses colonnes – par l’innovation et le développement de solutions pertinentes en terme d’habitat qui tiendraient d’avantage compte de l’évolution des modes de vie, de la modification de la structure familiale, du vieillissement de la population, de la dissociation entre travail et lieu de travail. C’est d’ailleurs ce qui compose l’actualité de ces derniers jours et semaines, que ce soit en France ou dans le reste du monde d’ailleurs : comment faire en sorte que le plus grand nombre puisse être logé décemment ? Comment lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil ? Comment repenser nos modèles de sociétés et nos politiques de logement, etc. ?
Sur la lutte conte l’habitat indigne (dont la définition ne sera pas modifiée malgré le recours de plusieurs associations auprès du conseil d’Etat pour la rendre plus précise et contraignante en matière de performance énergétique, le mal logement et les marchands de sommeil tout d’abord, dont les catastrophes de Marseille et de Bobigny nous ont tristement rappelé l’existence en France, si le Gouvernement semble vouloir avancer positivement quant à « sa volonté d’accélérer la construction de résidences sociales » (page 3), nombreux sont encore à alerter les pouvoirs publics, comme le président du Samu Social de Paris, sur le manque de places d’hébergement pour les sans-abris, et le
manque de politique de réinsertion dans des logements plus stables.
Publié dans Actualités, logement
Institut mutualiste montpelliérain : une cité de la santé et du bien-être @mutualite_fr
Publié par Alexandra Poloce
 Source : Mutualite Française
Source : Mutualite Française
La clinique Beau Soleil, qui est la plus ancienne clinique mutualiste de France, va devenir l’Institut mutualiste montpelliérain à l’horizon 2022. Situé au cœur de Montpellier, cet établissement innovant ambitionne de devenir une cité de la santé et du bien-être, grâce à une offre globale de soins et de services.
Publié dans Santé & Social
Étiquettes : assurance, Mutualité Française, protection sociale, réglementation, SANTÉ, social
Grand âge et autonomie : les propositions de la Mutualité Française @mutualite_fr
Publié par Alexandra Poloce
Source : La Mutualité Française

Le Conseil d’administration de la Mutualité Française a adopté une vingtaine de propositions couvrant les enjeux de prévention, d’accompagnement et de financement. Cette contribution est destinée à alimenter la concertation publique en amont d’une loi pour améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie, annoncée par le Président de la République d’ici fin 2019. Cette contribution est le résultat d’un travail mené avec les mutuelles membres de la Mutualité Française, d’un dialogue avec des dizaines d’acteurs institutionnels, personnalités qualifiées, syndicats, associations d’usagers du système de santé, fédérations, think tanks…, et de consultations citoyennes en ligne.
« Les mutuelles portent historiquement la cause du « grand âge », elles en sont les militantes : elles couvrent 70% des plus de 65 ans, gèrent plus de 460 établissements et services pour l’accueil des personnes âgées ou en situation de handicap dont 217 Ehpad, et proposent déjà de multiples dispositifs d’accompagnement à domicile. C’est avec cette expertise unique que la Mutualité Française a souhaité participer utilement au débat public en formalisant une vingtaine de propositions afin de contribuer à une meilleure prise en charge de la perte d’autonomie. »
Les vingt et une propositions sont articulées autour de quatre convictions :
Publié dans Santé & Social
Étiquettes : assurance, Mutualité Française, protection sociale, Réavie, réglementation, SANTÉ, social
Réduire la sous-occupation, un enjeu de taille @_GEFILS
Publié par Alexandra Poloce
> Source : « Gazette des Communes »
> Pour en savoir plus sur GEFILS et/ou vous abonner à l’EHebdo, rendez-vous sur www.gefils.fr, ou contactez schoepfer.a@gefils.fr
Réduire la sous-occupation, un enjeu de taille
La crise du logement est de plus en plus prégnante. Plus de 2 millions de personnes sont en attente d’un logement social. Et les grands appartements se font rares. Les familles nom-breuses ont du mal à obtenir un habitat adapté, surtout en zone tendue. En parallèle, des personnes âgées sont en sous-occupation. Les bailleurs sociaux tentent de convaincre les lo-cataires en sous-occupation de changer pour un studio ou un T2, ou ils favorisent les échanges directs entre locataires.
Les personnes âgées vivant seules – des femmes, le plus souvent – dans le T4 ou le T5 familial où les enfants ont grandi sont légion. Autant de cas typiques de « sous-occupation » de loge-ment social, alors que des ménages avec des enfants en bas âge cherchent à se loger. Mais on ne peut mettre les gens dehors, ni les forcer à changer. Or les résistances sont nom-breuses. Pourtant, plus de 2 millions de personnes sont en attente d’un logement social.
Dans la métropole lyonnaise, on compte plus de 6 000 demandeurs de logement social ; dont 40 % se trouvent déjà dans le parc social et sollicitent une mutation pour un appartement plus grand. Ainsi, Est métropole Habitat, l’office public de l’est de l’agglo lyonnaise (16 000 lo-gements), a décidé de travailler sur la « mutation suscitée ». Il a confié cette mission au GIE Est Habitat, qui regroupe quatre bailleurs de la région afin de mutualiser les travaux sur des questions transversales. Parmi celles-ci : la mobilité résidentielle.
« Nous allons nous atteler à la sous-occupation et à la mutation suscitée pour les personnes âgées qui vivent dans un logement trop grand, ce qui représente un enjeu important à Est métropole Habitat», détaille Etienne Fabris, responsable de la mobilité résidentielle au GIE Est Habitat. Chez ce bailleur, qui rayonne autour de Villeurbanne, sur 5 590 ménages comprenant au moins une personne de plus de 55 ans, 734 étaient en situation de sous-oc-cupation théorique, selon des données recueillies fin 2016 – soit 13 %.
En rez-de-chaussée
« Nous avons répondu à un appel à projets sur le vieillissement lancé par la métropole de Lyon, ce qui nous permet de financer un poste de chargée de relogement, poursuit Etienne Fabris. Sa mission : identifier les ménages dont les demandes d’adaptation du loge-ment au vieillissement n’ont pas été acceptées. » Par exemple, installer une barre de douche dans un appartement au quatrième étage dépourvu d’ascenseur n’est pas pertinent car, à terme, la personne devra vivre en rez-de-chaussée ou dans un immeuble avec ascenseur.
« La chargée de relogement va aussi repérer des situations telles que les séparations, le dé-part des enfants, la retraite… Et ce, afin de suggérer des mutations dans des appartements plus petits », souligne Etienne Fabris. La tâche n’est pas simple en raison d’un différentiel de loyer quasi systématique ; le loyer d’un T4 occupé depuis trente ans, qui n’a pas augmenté puisqu’il n’y a pas eu de relocation, est le plus souvent inférieur à celui d’un T2 neuf, qui est au prix du marché !
De quoi dissuader les mutations. « Aussi, le loyer du nouvel appartement où la personne va emménager est-il recalculé au prix du mètre carré de l’ancien logement », précise Etienne Fa-bris. Les bailleurs ne risquent-ils pas d’y perdre ? « Non, car le loyer de l’ancien appartement est, lui, mis au prix actuel du mètre carré, comme s’il avait augmenté au fil des années. »
Publié dans Actualités, logement
Pourquoi les collectivités doivent-elles continuer à garantir les organismes HLM ? @_GEFILS
Publié par Alexandra Poloce

> Pour en savoir plus sur GEFILS et/ou vous abonner à l’EHebdo, rendez-vous sur www.gefils.fr, ou contactez schoepfer.a@gefils.fr
Alors que la Loi ELAN impose un nouveau cadre financier aux bailleurs sociaux qui devrait conduire le secteur à se repenser en terme de métier(s), de taille (certains vont disparaitre, d’autres fusionner, d’autres se regrouper) ou encore de vision stratégique, la question des garanties d’emprunt est sur toutes les lèvres.
Alors que les collectivités locales rechignent de plus en plus à la donner, les banques la réclament… plus que jamais !
Il parait donc nécessaire, voire indispensable de faire un point sur le sens et les objectifs des garanties qui doivent être données par les collectivités locales en distinguant celles qui portent sur les bailleurs sociaux (quelle que soit leur forme juridique) de celles qui concernent d’autres compétences « externalisées » exercées de plus en plus souvent par une entreprise publique locale (SEM, SEMOP ou SPL).
En matière de logement social, nous aurons à distinguer les garanties demandées par la Caisse des Dépôts (CDC) au profit des bailleurs sociaux, de celles demandées par les autres établissements de crédits.
Pourquoi les collectivités doivent-elles donner leur garantie à la CDC ?
Publié dans Actualités, logement