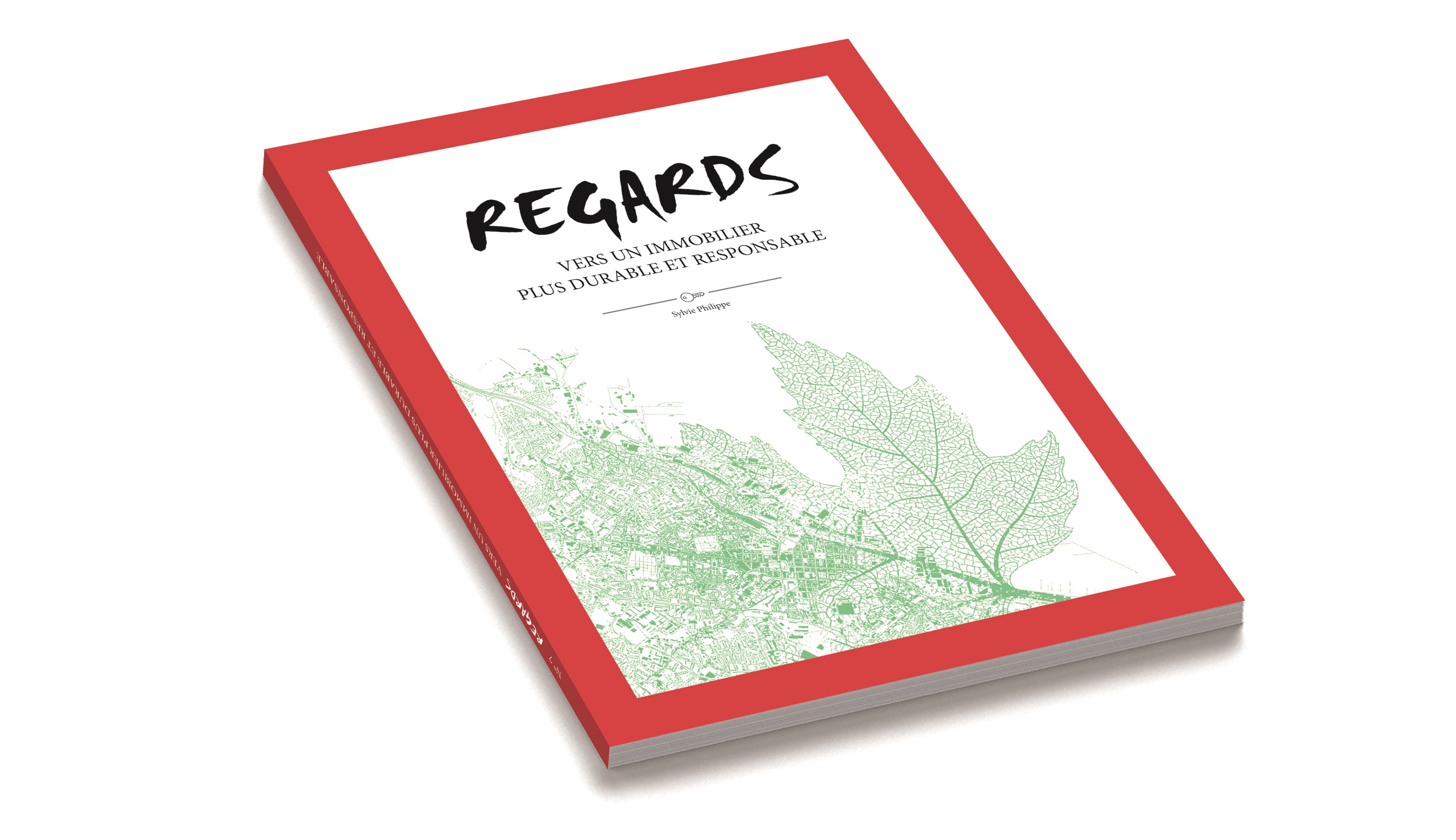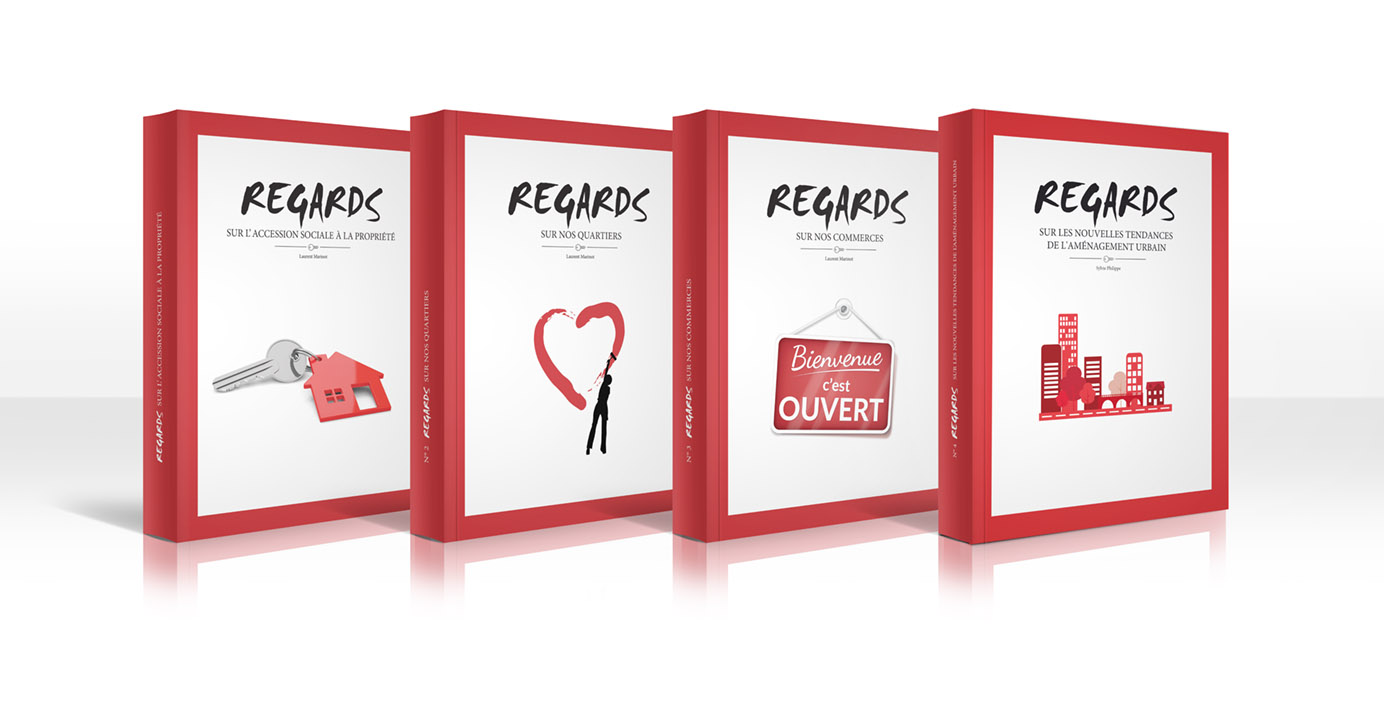Archives du 21 avril 2011
Mise en place de la réforme portuaire : une chance pour la compétitivité des ports français
La dernière étape de la réforme portuaire vient de s’achever. Aujourd’hui, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a officialisé la mise en place de cette reforme majeure à l’occasion d’un déplacement au port du Havre accompagné par Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement et Thierry MARIANI, secrétaire d’État chargé des Transports.
En transformant en profondeur leur organisation et leur fonctionnement, sur le modèle régissant les principaux ports européens, l’objectif final de la reforme est de renforcer la compétitivité des sept grands ports maritimes (GPM) français, Marseille-Fos, Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux.
■ La réforme s’articule autour de 3 axes principaux :
Recentrer les missions des ports sur leurs missions régaliennes,
L’autorité portuaire conserve les missions de police portuaire, de sécurité et de sûreté, en laissant la gestion des équipements aux entreprises privées.
Les personnels de manutention (grutiers, portiqueurs) sont désormais employés par les établissements publics portuaires et sont transférés vers les entreprises privés, comme c’est le cas pour les dockers depuis la réforme de 1992.
Refonder la gouvernance des grands ports maritimes
La réforme met en place un système à directoire et conseil de surveillance, où la représentation des acteurs économiques et des collectivités territoriales est accrue. Est également mis en place un conseil de développement, permettant de mieux associer les différents acteurs locaux concernés par le fonctionnement du port.
Organiser la coordination entre les ports d’une même façade maritime
Afin de promouvoir la complémentarité entre les ports géographiquement proches, la reforme prévoit une coordination entre les ports d’une même façade maritime, par exemple Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux, ou situés sur un même axe fluvial, par exemple Le Havre, Rouen, Paris.
■ Les étapes de la reforme
Le plan de relance des ports français a été engagé dès 2008. La première étape de la réforme a consisté à mettre en place un nouveau cadre législatif nécessaire à la modernisation des ports : c’est la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et créant les sept grands ports maritimes. Cette réforme est aujourd’hui achevée. La nouvelle gouvernance est en place. La dernière étape de la réforme concernait le transfert des outillages et des personnels de manutention vers les entreprises privées. Apres presque deux ans de négociations, les partenaires sociaux ont signé le 15 avril 2011, un accord national sur les métiers portuaires, et un accord de pénibilité retraite ouvrant droit a une cessation anticipée d’activité de deux ans.
■ Objectifs économiques de la réforme :
Aujourd’hui, la moitié des marchandises qui arrivent en France par mer sont débarquées dans un port étranger. Grâce à la réforme, l’enjeu est de récupérer au moins 50% de ce trafic pour les ports français.
Les ports français bénéficient de nombreux atouts :
– des emplacements géographiques qui les placent comme premier point d’entrée en Europe ;
– des équipements modernes et performants ;
– des réserves foncières importantes pour leur développement.
La réforme doit leur apporter la fiabilité, c’est-à-dire la garantie pour leurs clients d’être traités rapidement et sans risque social.
Pour mettre les ports en capacité de capter de nouveaux trafics, la question de la desserte est maintenant primordiale : dessertes ferroviaires, dessertes fluviales (canal Seine nord Europe), dessertes maritimes (les autoroutes de la mer et le cabotage).
Au total, 2,4 Mds € sont consacrés aux investissements portuaires, plus 4,3 Mds € pour le canal Seine-Nord.
– 6 500 personnes concernées par l’accord national de branche
– 900 personnes sont en cours de transfert des ports vers les entreprises privées
Télécharger le communiqué de presse (PDF – 202 Ko)
Contact presse :
Cabinet de Thierry MARIANI – Marion LAMURE :01 40 81 71 66
Le service d’assainissement en France : principales données 2008

La quatrième enquête sur les services publics d’eau et d’assainissement portant sur 2008 confirme la poursuite du développement de l’assainissement collectif par les communes, qui concerne 82 % des logements français. Si son organisation communale régresse tendanciellement depuis 1998, sa gestion en régie semble regagner du terrain par rapport à 2004. Un quart du réseau de collecte, soit 95 000 km, concerne les seules eaux pluviales.
Les eaux rejetées par deux tiers des logements raccordés profitent d’un traitement tertiaire. En forte hausse par rapport à 2004, trois quarts des communes ont mis en place leur Service public d’assainissement non collectif (SPANC)… Télécharger l’étude
Présentation de l’étude « Villes et marchés du carbone » par CDC Climat Recherche et l’OCDE
 Mardi 19 avril, CDC Climat a organisé, en collaboration avec l’OCDE, une présentation de l’étude « Villes et marchés du carbone – Mécanisme pour un développement propre et mise en œuvre conjointe : bilan de l’expérience des villes ».
Mardi 19 avril, CDC Climat a organisé, en collaboration avec l’OCDE, une présentation de l’étude « Villes et marchés du carbone – Mécanisme pour un développement propre et mise en œuvre conjointe : bilan de l’expérience des villes ».La présentation de l’étude par deux de ses auteurs, Jan Corfee-Morlot (Direction de l’environnement, OCDE) et Alexia Leseur (CDC Climat Recherche), a été suivie d’une table-ronde sur le thème « Quels financements innovants pour la mise en œuvre des Plans énergie-climat territoriaux ? », avec les interventions de :
- Bruno Charles, Vice-président du Grand Lyon en charge de l’agenda 21, du plan climat et de l’énergie,
- Olivier Degos, Délégué régional au Développement durable et solidaire du Conseil régional d’Aquitaine,
- Joaquim Oliveira-Martins, Chef de la division Développement régional de l’OCDE,
- Pierre Ducret, PDG de CDC Climat.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site CDC CLIMAT
Le Toit Angevin, un des pionniers de l’ISO 26000


Le Toit Angevin est l’une des premières entreprises en France évaluées au regard de la norme « ISO 26000 », publiée le 1er novembre dernier, avec des résultats très encourageants. A l’issue de l’audit mené entre fin 2010 et le premier trimestre 2011 par Vigéo, le degré de maturité de l’entreprise en matière de RSE (responsabilité sociale des entreprises) a ainsi été jugé « probant », sur une échelle de quatre niveaux : Non-tangible – Amorcé – Probant- Avancé.
Dix-huit objectifs ont été examinés, autour de sept enjeux-clés de RSE : la gouvernance, les droits de l’homme, les relations et conditions de travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et le développement local.
Selon la déclaration à l’AULH d’Éric Lamoulen, Directeur Général, deux points forts ont été mis en évidence par l’audit : « Il s’agit d’une part de notre relation avec les locataires à travers la concertation, les démarches qualité et le dialogue avec nos personnels et, d’autre part, notre action sur le territoire, nos relations avec les collectivités locales et notre utilité économique et sociale ». Par ailleurs, les efforts de prévention de la corruption et de la fraude interne et de promotion du dialogue social et de la négociation collective ont également été soulignés.
Ces résultats sont le fruit d’une vision et d’une politique portée depuis 2007, concrétisée par un travail au quotidien auprès des parties prenantes internes et externes de l’entreprise.
L’audit a également permis de mettre en lumière le potentiel de progrès et les aspects à améliorer, auxquels le Toit Angevin va à présent s’atteler. Des efforts accrus vont ainsi se porter sur le renforcement de sa politique environnementale et l’intégration de critères sociaux et environnementaux à son processus d’achat.
(Source: AULH)
Rouen : 100 hectares à reconquérir en plein cœur de ville
Au terme d’une longue concertation associant les communes à l’agglomération rouennaise, la Sem Rouen Seine Aménagement et la Spla Créa Aménagement pilotent un double projet d’écoquartier qui vise à reconquérir 100 hectares d’anciennes emprises portuaires. Une opération d’une ampleur rare qui promet de changer le visage de la Ville.
L’écoquartier Flaubert couvrira à lui seul 90 hectares. © Créa Aménagement
Que faire d’une enclave de 100 hectares située à proximité immédiate d’un centre urbain ? C’est la question qu’ont eu à se poser les responsables de l’urbanisme de l’agglomération de Rouen. Face à cette opportunité rare, la réponse de l’écoquartier s’est imposée d’elle-même. Ce sera donc non pas un, mais deux écoquartiers qui vont émerger de part et d’autre de la Seine à proximité du nouveau pont Flaubert. Baptisé Luciline rive de Seine, le plus petit des deux (10 hectares environ) a été confié à la société d’économie mixte Rouen Seine Aménagement. Les premiers bâtiments devraient sortir de terre d’ici à 2013, avec l’objectif de construire à terme 1 000 logements dont 25 % sociaux, 40 000 m2 de bureaux et 20 000 m2 de locaux d’activités à vocation tertiaire. Dans cette optique, le recours à l’énergie géothermique sera généralisé. L’ensemble sera lové dans des espaces végétalisés tirant le meilleur parti de la proximité de la Seine avec notamment la mise à jour et la valorisation de la rivière souterraine dont le quartier tire son nom, la Luciline. Autre point fort : « le quartier bénéficie déjà d’une structure en matière de transports en commun avec le passage d’une ligne de bus en site propre », explique Ida Ricci, chargée de l’opération.
La part du lion sera toutefois réservée à l’écoquartier Flaubert, confié par l’Agglomération à la Spla Créa Aménagement. Ce dernier concerne à lui seul les 90 hectares restants, situés sur l’autre rive de la Seine. Après la transformation en 2010 d’une ancien hangar portuaire en une salle de musiques actuelles, les quais et la presqu’île l’entourant vont être réaménagés d’ici au printemps 2013 en un espace vert de 20 hectares. Une première opération de 15 millions d’euros, qui préparera le terrain pour l’aménagement de l’écoquartier à proprement parler. En effet, si les premiers immeubles devraient sortir de terre dès 2014, il faudra entre 20 et 25 ans pour mener à bien l’ensemble du projet, tant son emprise est vaste. D’où des chiffres qui donnent le vertige : 650 000 m2 de surfaces construites, dont 165 000 à vocation économique, 230 000 pour l’habitat et 255 000 pour les équipements collectifs, le tout cerné de verdure et relié par les transports en commun. « Il s’agit de recréer une continuité urbaine pour permettre le retour de 10 000 habitants qui demain viendront y habiter, y travailler ou s’y divertir », explique Luc Pinon, chargé de l’opération.