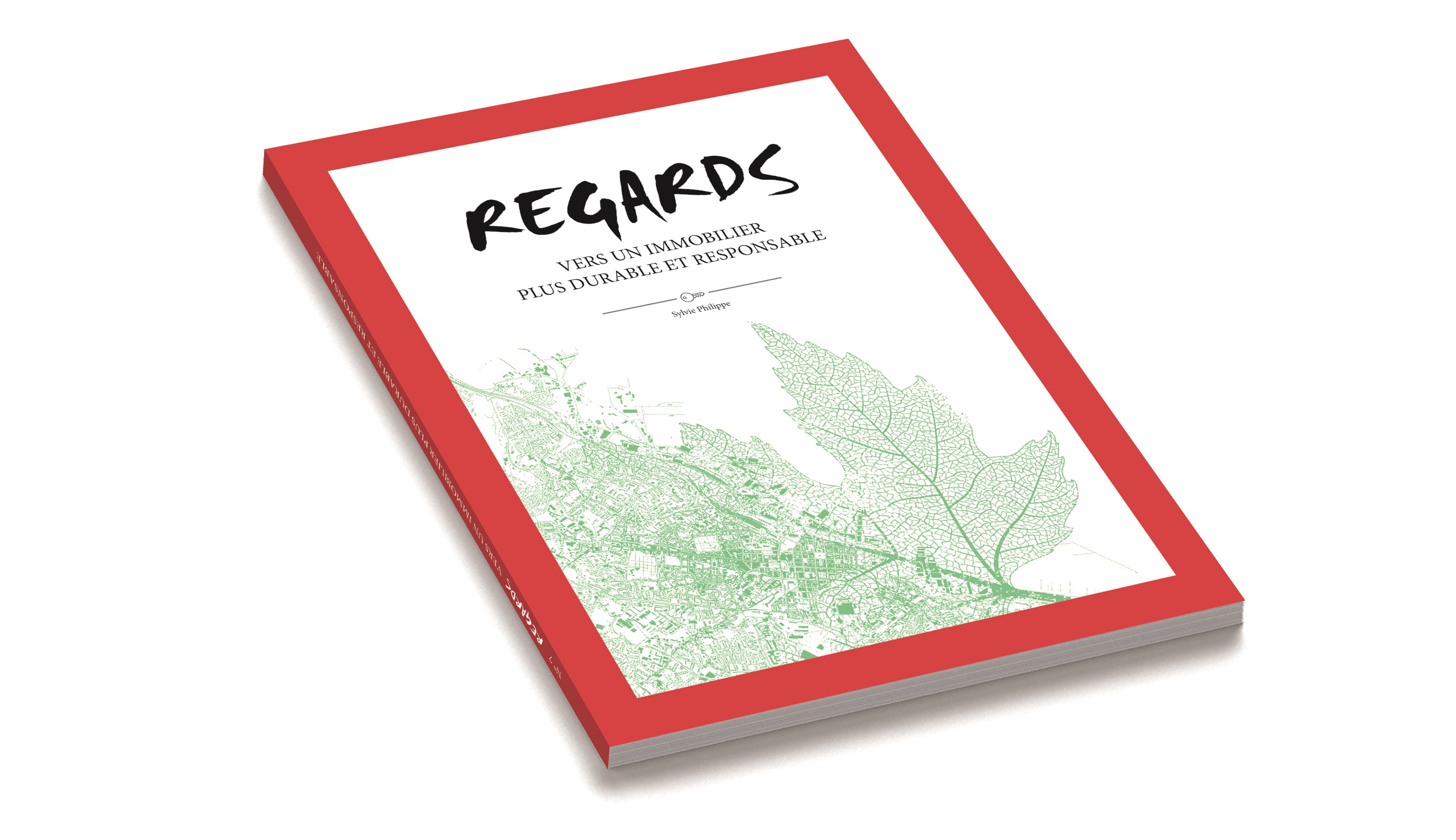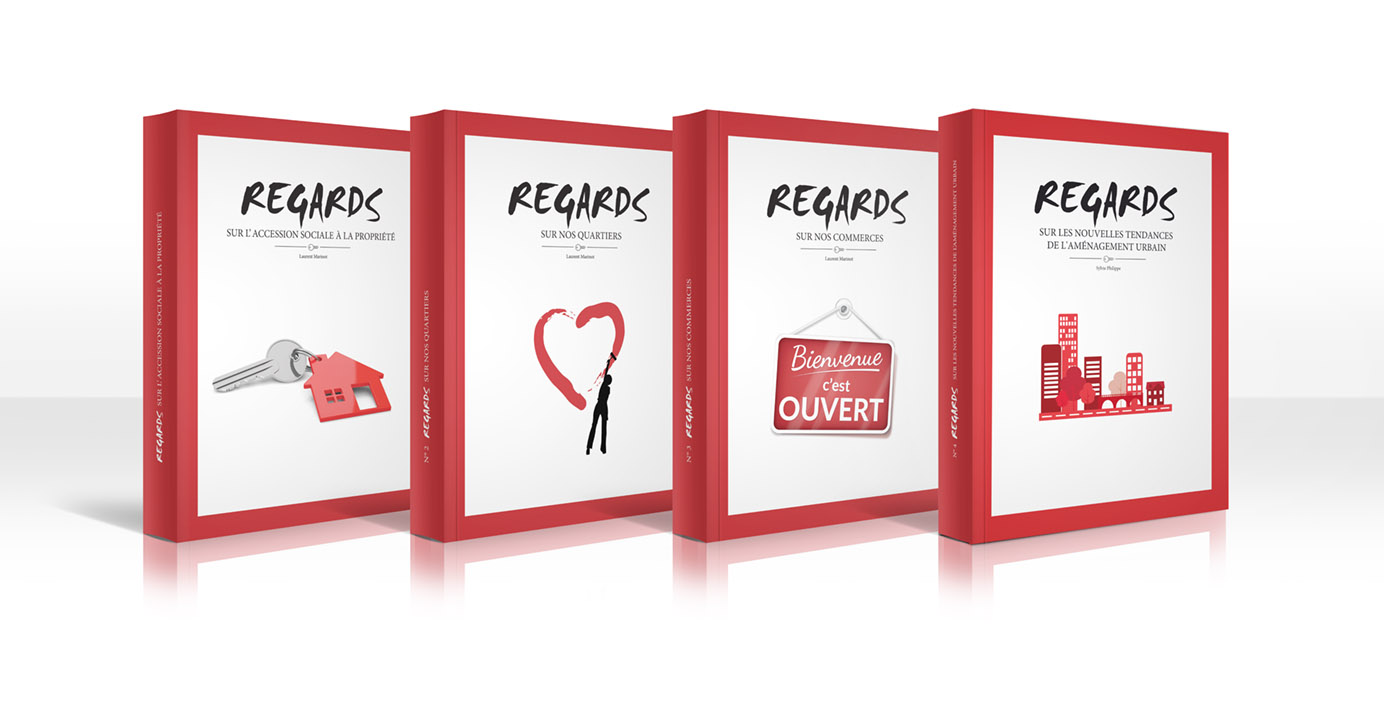Archives Mensuelles: février 2020
Interview Jean-Baptiste Fontes, Fondateur @lexilife_fr qui a conçu une lampe pour aider les dyslexiques @CES @cmarkea
Présent lors de la soirée de restitution du CES Las Vegas 2020 organisée par Arkea Banque E&I pour présenter Lexilight, la lampe d’aide à la lecture pour les dyslexiques,
>Jean-Baptiste Fontes, Fondateur & CEO, LEXILIFE a accepté de répondre à nos questions
Le blog des institutionnels : Comment est née l’idée ?
Jean-Baptiste Fontes : L’aventure Lexilife commence par la mise au point d’une lampe révolutionnaire, Lexilight, capable de faciliter la lecture à des millions de dyslexiques. Après avoir mis à profit 20 ans de recherche française, avoir finalisé un prototype et l’avoir testé, les conclusions sont évidentes : près de 90% des dyslexiques affirment lire sans effort un texte éclairé par la lampe.
Jean-Baptiste Fontès, fondateur de Lexilife, décide d’en faire profiter le plus grand nombre. Les coûts de fabrication et le prix de vente sont encore élevés, mais plus elle sera connue et adoptée, plus elle sera accessible. Entouré de Thomas Zuber pour son expertise scientifique et de Paola Bourdon pour ses talents en marketing, Jean-Baptiste se lance dans le déploiement de la lampe. Actuellement, Lexilife compte 9 salariés et a investi près de 1,2 millions d’euros dans la recherche et développement depuis son lancement en 2018.
Rapidement, l’équipe se heurte à plusieurs obstacles liés à la méconnaissance de la dyslexie par la société entière, particuliers comme institutions. L’équipe, concernée par ce trouble à titre professionnel et personnel, y voit une cause à défendre. En effet, 8 à 10% de la population doit vivre avec un trouble méconnu, parfois nié, parfois raillé… souvent caché.
Lexilife est donc une entreprise engagée qui, non seulement avec la lampe Lexilight, mais aussi par de nombreuses actions (Recherche et Développement, sensibilisation des institutions, etc) oeuvre pour le mieux vivre des personnes dyslexiques.
Le blog des institutionnels : Comment ça marche ?
Jean-Baptiste Fontes : Lexilight est la première lampe au monde permettant aux dyslexiques de lire normalement. S’appuyant sur une découverte scientifique bretonne révolutionnant le monde de la dyslexie, Lexilife a créé la lampe Lexilight grâce au savoir-faire du dernier fabricant breton d’éclairage, la société Thomas Watt Lighting Pro.
Particularité du dyslexique : ses deux yeux sont dominants. Ils envoient simultanément deux informations différentes au cerveau. C’est cette confusion qui crée des images miroirs et perturbe sa lecture.
La lampe Lexilight permet au cerveau de traiter l’information comme si elle provenait d’un seul œil dominant. Les images miroirs disparaissent et le dyslexique retrouve un confort de lecture immédiat.
Durant deux ans nous avons testé cette technologie avec un large panel de 300 testeurs, ayant entre 7 ans et 68 ans. Ces tests privés, dans nos locaux, nous ont permis de valider notre technologie et de voir que près de 90% des utilisateurs ayant testé notre lampe ont confirmé des bénéfices immédiats : réels progrès dans la lecture, visualisation des espaces, regain de confiance et plaisir de lire.
Le blog des institutionnels : Où et comment est conçue lexilight ?
Jean-Baptiste Fontes : Lexilife est fortement engagée dans une démarche sociale et environnementale. Tout notre packaging est totalement recyclable et nous essayons de réduire au maximum notre impact sur l’environnement.
Lexilife s’inscrit également dans une démarche sociale globale. C’est en accord avec ces valeurs que Lexilife fait construire ses lampes en France à Saint Malo dans une usine de travail adaptée ayant l’agrément ESUS. L’Atelier du Courrier, où 98% de ses salariés sont en situation de handicap, assemble les lampes Lexilight depuis 2018.
Par ailleurs, la fabrication française est une démarche chère à Lexilife, qui a également fait appel à l’usine ASICA de Saint Malo pour fabriquer tous les composants électroniques de la lampe Lexilight.
Le blog des institutionnels : Quelles sont vos principales cibles ? en France et à l’étranger ?
Jean-Baptiste Fontes : La lampe Lexilight est une innovation mondiale qui permet aux personnes dyslexiques de mieux vivre au quotidien avec leur trouble de la lecture.
Lexilife souhaite lutter contre les préjugés sur la dyslexie. Informer, échanger et dédramatiser auprès du grand public (comme auprès de certaines institutions, privées ou publiques) est le meilleur remède pour changer le regard de toute la société sur les dyslexiques.
Lexilife a un regard résolument positif sur la dyslexie. Les dyslexiques possèdent des aptitudes différentes et une autre façon de penser. C’est leurs forces qu’il faut mettre en avant, et non leurs faiblesses.
Notre ambition est de révéler le potentiel de chaque dyslexique et lui faire prendre conscience de ses capacités. La dyslexie ne doit pas être une condamnation à l’échec.
La communauté Lexilife rassemble enfants, parents, proches, orthophonistes et professionnels de l’éducation. C’est par l’échange et le partage de vécu que nous ferons bouger les choses.
Le blog des institutionnels : Avez-vous d’autres projets ?
Jean-Baptiste Fontes : L’année 2020 sera marquée par deux principaux axes : la science et le déploiement. Nous avons pour objectif de mettre en place des essais cliniques début 2020 ayant pour but final de rendre la lampe dispositif médical et permettre un remboursement de celle-ci.
Nous souhaitons travailler avec des partenaires engagés (comme Arkea) qui pourraient nous aider à rendre la lampe accessible au plus grand nombre (via la mutuelle ou autres partenariats à prévoir).
En parallèle nous allons accélérer notre déploiement national et international via des relais distributeurs sélectionnés et partenaires.
> Pour plus d’informations : lexilife.com
Propos recueillis par Alexandra Poloce – Marine Cotreuil
Retour sur le colloque Marianne Solidarités 28 novembre 2019 #vidéo
Organisée par l’Association Marianne Solidarités, la matinale « Habitat solidaire : quelles solutions pour une ville véritablement inclusive ? » s’est tenue le 28 novembre 2019, au sein du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE). Elle faisait suite au premier colloque de l’association, organisé en 2018, portant sur les solidarités intergénérationnelles.
Plus de 80 participants, dont des chercheurs et spécialistes du vieillissement, des élus, des membres d’associations, des mutuelles, des bailleurs y ont assisté pour échanger et mutualiser les bonnes pratiques et expériences en matière d’habitat inclusif et solidaire.
« Face au constat du vieillissement de la société, l’enjeu est de trouver des solutions pour faire cohabiter les générations, les cultures et les fragilités de toutes sortes », a expliqué dans son allocution d’ouverture Michel LANGLOIS, Président de Marianne Solidarités. « L’habitat se place comme un vecteur privilégié pour atteindre cet objectif : il se doit d’être accessible, solidaire et bien intégré dans son environnement. Le vivre-ensemble n‘est pas un slogan mais une pratique du quotidien ».
Les intervenants, François-Xavier ALBOUY chercheur, Dr Elena ALONSO médecin, et – Pierre-Marie CHAPON spécialiste du vieillissement, ont rappelé les conditions d’une avancée en âge harmonieuse sur les plans physiques et psychologiques :
• Conserver une activité tournée vers l’extérieur qui ait un sens pour la personne,
• Porter un regard positif sur son statut de senior,
• Bénéficier de liens sociaux de proximité de qualité,
• Prendre soin de soi,
• Continuer à acquérir de nouvelles connaissances,
• Evoluer dans un environnement adapté.
Conçu autour de l’idée que le lien social intergénérationnel est bénéfique à tous, le modèle solidaire et participatif des Maisons de Marianne a en ce sens fait ses preuves. Comme en témoignait Sylvie COUCHOT, Maire de Vauréal (95) : La résidence Mary Poppins inaugurée il y a un an permet aux habitants, quel que soit l’âge, de se retrouver quotidiennement dans les espaces partagés, de participer aux animations, de s’entraider et de partager leurs talents. « C’est une vraie réussite due en grande partie à la qualité de la présence humaine assurée par la coordinatrice de site. »
Un habitat solidaire et inclusif permet de prolonger l’âge moyen sans incapacité, réduisant ainsi le coût pour les ménages et la collectivité. Il offre ainsi une solution concrète et économique aux besoins de sécurité, de lien social et de bienveillance, exprimés par les personnes les plus fragiles.
En conclusion, Monsieur Boubacar BAH, Ministre du Mali des collectivités et de la décentralisation qui a très aimablement accepté de répondre à notre invitation, a fait une intervention très remarquée sur les formes de solidarité intergénérationnelle au Mali dans les régions urbaines, péri-urbaines ou rurales, tout en évoquant au passage des expériences vécues dans la Seine-Saint-Denis au cours de sa vie étudiante et dans le Val d’Oise.
Seine-Saint-Denis habitat obtient la certification Iso 9001 pour son activité de maîtrise d’ouvrage @SSDhabitat
Source : Seine-Saint-Denis Habitat

Le 20 janvier 2020, à l’occasion du séminaire annuel et de la cérémonie des vœux, Stéphane Troussel, président de Seine-Saint-Denis habitat, et Patrice Roques, directeur général, ont officiellement annoncé l’obtention de la certification ISO 9001 sur l’activité de maîtrise d’ouvrage de l’Office. Cette certification de l’Afnor vient valoriser l’un des cœurs de métier essentiel de l’Office et récompense l’engagement de toutes les équipes pour une amélioration continue de leurs pratiques.
Dans le cadre de l’ANRU1, l’Office a réalisé 15 projets qui ont concerné plus de 12 500 logements pour un investissement de 602 millions d’euros. Pour la période 2018-2027, l’Office engagera 643 millions d’euros dans 15 nouveaux projets de rénovation urbaine (PRU). Par ailleurs, un très ambitieux programme de réhabilitation va permettre de réhabiliter 11 000 logements (hors rénovation urbaine) entre 2019 et 2029, pour un montant de 320 millions d’euros. Au total, dans les 10 prochaines années, l’Office investira plus d’1 milliard d’euros dans quelque 20 000 logements en réhabilitation, résidentialisation, construction et réaménagement urbain.
…Lire la suite
L’Etat lance un plan contre les logements vacants @pap_fr #Immobilier
Source : PAP

La ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, et le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, ont lancé ce 10 février 2020 un appel en ce sens aux propriétaires de biens immobiliers résidentiels inoccupés. « 200.000 logements du parc privé sont structurellement vacants dans les territoires tendus », indique le communiqué. « C’est une ressource pour mettre sur le marché une offre complémentaire à la construction neuve. C’est une vraie alternative à l’étalement urbain. »
Mieux connaître la vacance. Le plan concocté par Jacqueline Gourault et Julien Denormandie mise sur trois leviers. Il s’agit, dans un premier temps, « d’identifier » les logements vacants dans les villes où l’offre est inférieure à la demande. En utilisant « des données jusqu’alors inexploitées, le plan permettra de cartographier la vacance et d’en comprendre les causes », précise le communiqué. Les pouvoirs publics sauront par exemple si un bien n’est pas loué en raison de sa trop grande vétusté ou si son propriétaire ne veut pas le louer par crainte des impayés de loyers.
Incitations, aides et garanties. Le deuxième levier, c’est l’incitation. Une fois les origines de la vacance identifiées, un dialogue sera mis en place avec les propriétaires concernés. Pour les biens dégradés, les ministres comptent communiquer en mettant en avant la plateforme Facilhabitat. Cette dernière, gérée par l’Anah, intègre de nombreuses infos, notamment sur les travaux et les aides financières. Les propriétaires qui craignent les impayés seront sensibilisés sur la garantie Visale®. Gratuite, prenant en charge trente-six mois d’impayés de loyers ainsi que les dégradations, elle a séduit 200.000 propriétaires.
Place à la réquisition ? En cas d’échec, le gouvernement passera à la vitesse supérieure, avec la possibilité de réquisitionner les logements vacants. Mais attention : seuls ceux détenus par des personnes morales (banques, sociétés d’assurance) seraient concernés. Dans un entretien au Parisien, Julien Denormandie rappelle qu’il préfère « accompagner et inciter ». S’il ne « s’interdit rien par principe », il estime que « pour les particuliers, il est très difficile de réquisitionner car le droit de propriété est, dans notre pays, l’un des plus protecteurs et c’est normal ».
#Logement : Investir les toits ? @Demain_la_Ville
Source : Demain la Ville

De l’espace, enfin !
Cela fait maintenant quelques années que l’investissement des toitures s’installe dans le paysage : rooftops branchés, belvédères, agriculture urbaine… l’espace public prend de la hauteur. Dans des espaces ultra-densifiés, certaines villes tentent de réinventer l’occupation des toits.
En plein cœur du 9e arrondissement de Paris, 40 boulevard Haussmann, difficile d’imaginer une centaine de personnes en train de patiner sur la glace pendant la période de Noël. C’est pourtant ce qu’a proposé le magasin des Galeries Lafayette dans la capitale, au cours du mois de décembre. Les curieux étaient invités non pas à l’intérieur, ni au sous-sol du magasin, mais… sur le toit de l’immense bâtiment haussmannien. Et ils sont venus nombreux !
Alors que la surface du sol parisien est comptée, voire millimétrée (le prix au mètre carré à Paris est de, rappelons-le, 10 400€ en moyenne) comme c’est déjà le cas dans de nombreuses métropoles mondiales, il s’agit désormais de réinvestir le bâti existant et d’en utiliser toutes ses dimensions. Ainsi, depuis plusieurs années, on voit des projets d’occupation de toits se multiplier et investir les hauteurs de diverses façons. Parmi les nombreux exemples, l’école d’Architecture à Nantes accueille un cinéma à ciel ouvert, tandis qu’à Angers, les toits de la patinoire accueillent des panneaux photovoltaïques ainsi qu’une centrale électrique.
Habiter, jardiner, se divertir ou se restaurer sur un toit est un concept original. Les différents usages des toits ne cessent de se répandre et le terme souvent employé de « cinquième façade » parle de lui-même : les toits sont devenus des espaces attractifs pour un concept novateur en devenir. Urbanistes et architectes se donnent d’ailleurs à cœur joie de les investir et de conceptualiser de nouvelles formes pour ces espaces littéralement « hors du commun », ou en tout cas au-dessus du commun.
Le constat s’est opéré d’ailleurs à la suite de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le soir même, architectes et designers dévoilaient leurs mille et un projets de nouvelles toitures, vertigineux. Espaces originaux à investir ou terrains facilement dissimulables, comment cette « cinquième façade » est-elle appréhendée ? De quelle manière nos modes de vie urbains en sortent-ils modifiés ?