Vers un marketing territorial social, donc communicant
Source : site de CAP’COM rubrique Opinions
Il y peu, lorsque je suis tombé sur un article du site zones mutantes évoquant le « capital social » des territoires, j’ai immédiatement adopté la formule qui rejoint exactement nombre de mes constats. J’ai aussi bien noté que l’occasion était venue pour les communicants publics de donner une petite leçon aux marketeurs territoriaux. Mais comme je tente de jouer dans les deux camps, dites-vous bien que cette affirmation est tout sauf acrimonieuse.
Le texte de zonesmutantes.com, signé Pierre Chapignac, part entre autres des thèses de Robert D. Putnam, professeur d’administration publique à Harvard, qui définit la notion de capital social par 3 aspects.
Un aspect structurel en premier lieu : c’est d’abord le maillage ou « la connectivité » du territoire. Dit autrement, il s’agit du réseau de relations existant sur un territoire. Et de définir cette formule : « La propension du territoire à créer (en quelque sorte sa productivité créatrice) est proportionnelle à la densité sociale du territoire, c’est-à-dire sa connectivité. »
Un aspect fonctionnel ensuite : il s’agit ici des ressources (mobilisées ou mobilisables) de ce réseau et de ce qu’il produit collectivement.
Un aspect culturel enfin : là, il est question du fonctionnement de ce réseau et des conditions de sa productivité, qu’il s’agisse de sociabilité, de proximité, de confiance ou encore de démocratie … L’auteur de préciser que « plus la connaissance mutuelle, la proximité et la confiance sont consistantes et plus la dynamique collective est créatrice de valeur, dans le sens économique comme dans le sens social de ce terme ».
Il semblerait que l’enjeu consiste bien à se donner les moyens de démultiplier les occasions de création de relations (la « proximité multiforme » et les « frottements entre des acteurs très divers »), puis ceux de leur pérennisation. C’est là que le communicant se frotte les mains et entre en piste ! Car qui dit relation, dit communication.
C’est un fait, les marketeurs territoriaux ont depuis quelques années cheminé assez vite dans leurs propres réflexions et, petit à petit, le sentiment que leurs armes habituelles ne suffisaient sans doute pas s’est fait jour. Effectivement, les études (inévitables) d’experts (incontournables) sur les facteurs d’attractivité, celles tentant de rationaliser les mécanismes décisionnels des investisseurs ou des entrepreneurs, ou les éternelles grilles « SWOT », ont montré, doucement mais sûrement, leurs limites. En particulier par la standardisation des modèles de pensées, donc une certaine banalisation des solutions apportées sous forme de cette équation dite « miracle » : [portrait identitaire + mobilisation des institutionnels + une « marque » et son cahier + un peu de pub = succès assuré]. Nombre de voix se sont donc élevées pour plaider en faveur de la recherche des atouts immatériels des territoires – souvent les seuls éléments véritablement discriminants – et pour inciter à quitter le seul champ cognitif pour instiller dans les démarches autant d’irrationnel, de sensibilité et d’affectif que possible. Et pourquoi pas de l’humain ? Ce que nous rappelle Putnam est de cet ordre : et si la richesse et le potentiel d’un territoire reposait d’abord sur les femmes et les hommes qui le composent et sur la connectivité qui les relie ? Et qui dit « êtres humains » et « relations entre des êtres humains », dit normalement « communication ». Au moins au sens le plus noble du terme. Voici donc une mission pour SuperCommunicant !
La première mission d’un communicant (public ou privé d’ailleurs) est de créer des liens avec ses publics et de les animer, de les entretenir. Théoriquement, le professionnel de la relation (et des moyens de la développer, de la provoquer et de l’enrichir sans cesse), c’est bien le communicant. Contrairement aux idées reçues, ses tâches principales ne relèvent pas de l’achat d’espaces publicitaires ou de parades dans les cocktails. Son quotidien est plutôt orienté vers la recherche de la synergie de toutes les idées et de toutes les énergies pour tisser du lien social et l’alimenter. Certes, ces actions sont peu visibles (donc impossible de les faire concourir pour le moindre trophée. Et pourtant …) ; elles sont néanmoins le fondement indispensable à la suite du déroulement des missions des dircoms publics. Les bases théoriques mobilisées ici valant bien celles de Philip Kotler ou de la bande du Mercator. Fondées sur les sciences humaines et sur l’analyse de la communication interpersonnelle, elles doivent permettre aux communicants d’être, sur ces sujets, la ressource ad hoc.
Parce que le marketing territorial a obligé (pour faire court) les territoires à s’interroger sur leurs racines, sur ce qu’ils étaient et sur ce qu’ils espéraient devenir, il a révolutionné les pratiques des communicants en leur demandant d’oublier les solutions toutes faites pour créer des solutions parfaitement appropriées à un territoire donné et totalement fondées sur l’identité et les valeurs – l’âme peut-être ? – d’un territoire. Et cela a sacrément aéré nos plus anciennes, et parfois sclérosées, pratiques. En retour, ces mêmes communicants peuvent-ils apporter à leurs collègues leur inestimable savoir-faire dans ce qui peut relier durablement entre eux les hommes (et sans aucune référence à un ancien slogan d’EDF, n’en déplaise aux amateurs de l’ancienne Nuit des Publivores). Promis, on va arrêter de se croire compétents en développement économique et touristique et on ne va faire que notre métier. Mais tout notre métier. Vous verrez, professionnels du marketing territorial, cela va vous être très utile !
Publié le 4 octobre 2013, dans Actualités, et tagué Cap'Com, Collectivités, collectivités locales, communication, marc thebault. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.

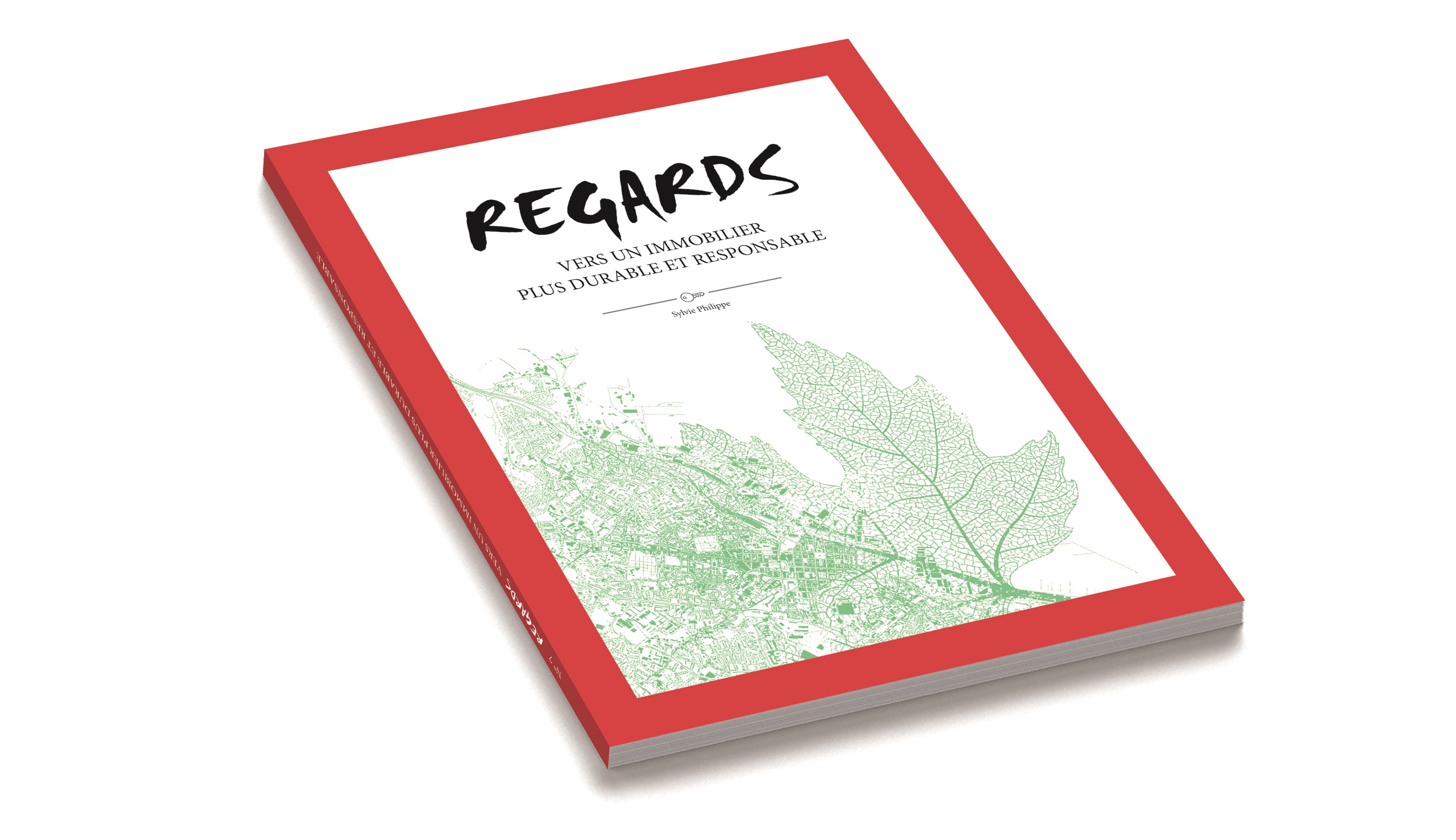
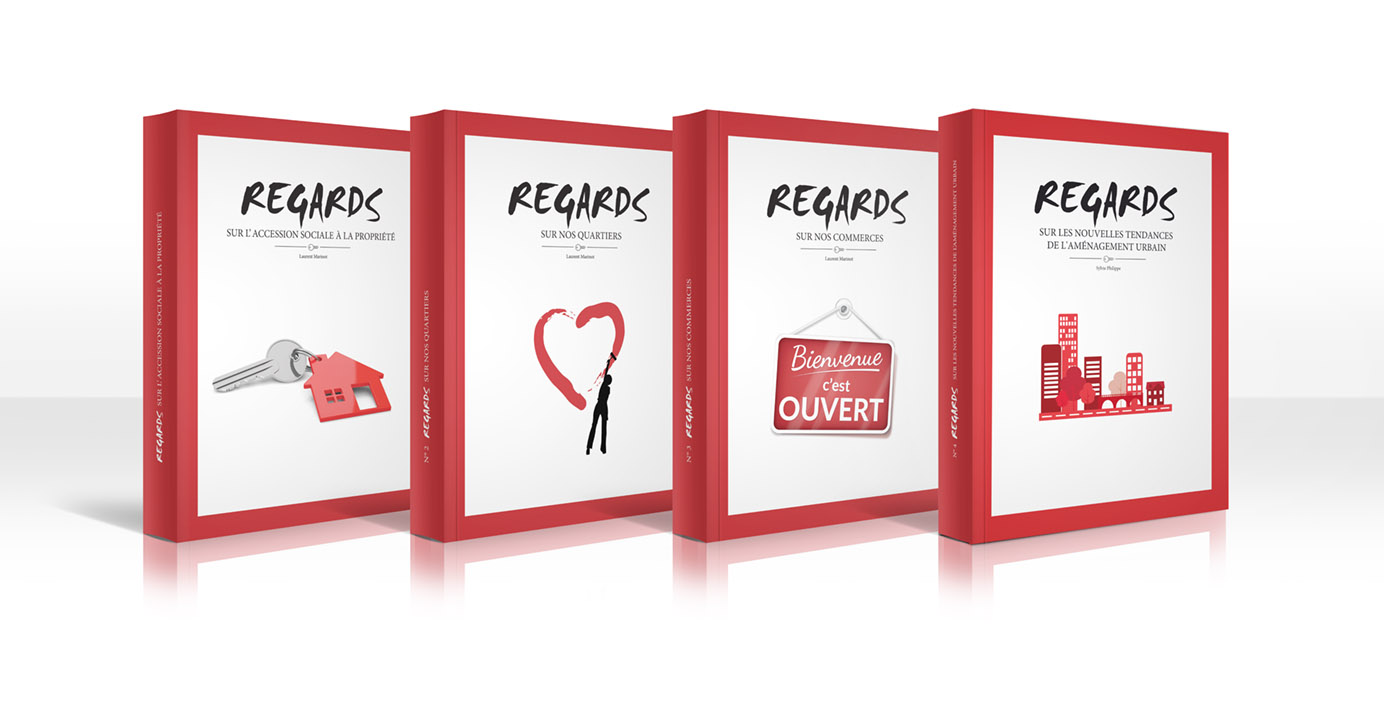

Poster un commentaire
Comments 0