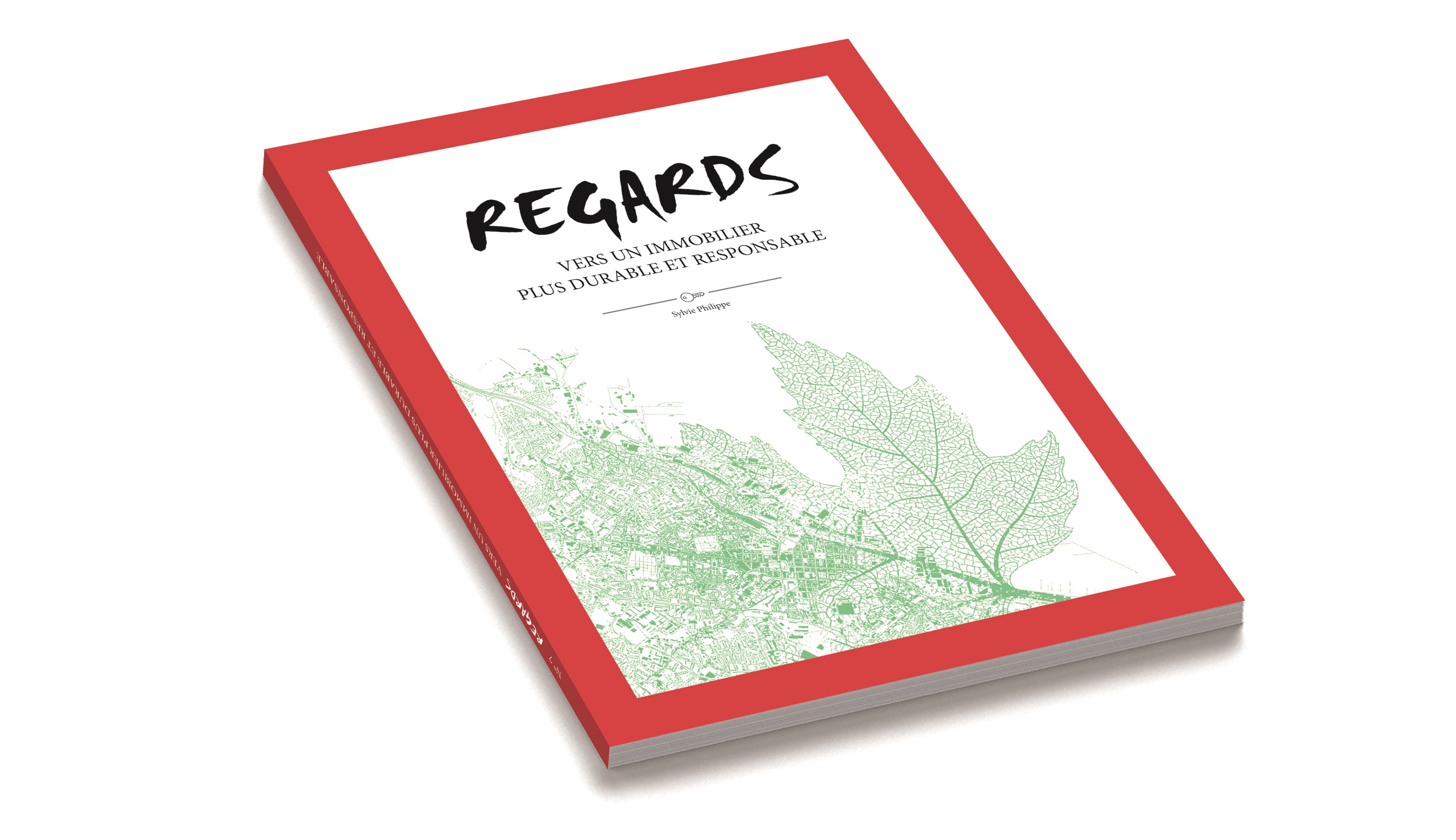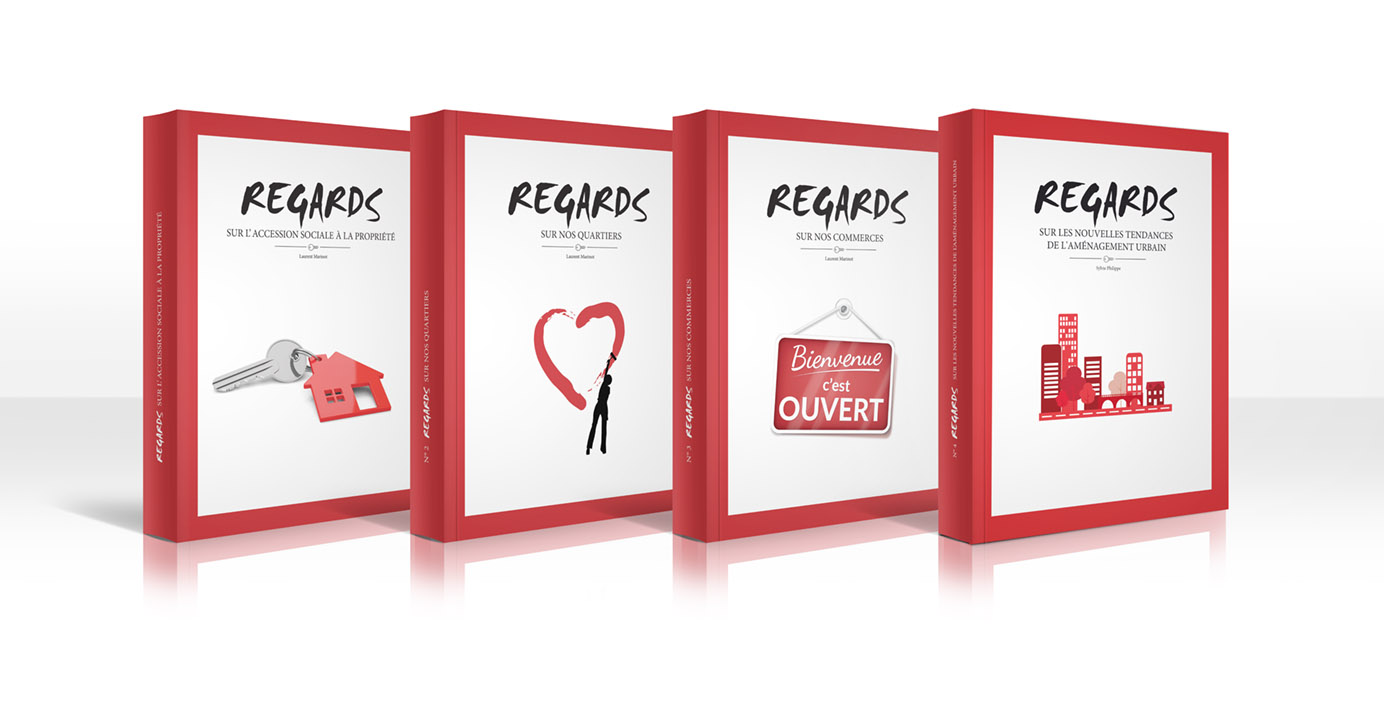Archives du 17 avril 2011
Le taux d’inflation annuel de la zone euro en hausse à 2,7%
Le taux d’inflation annuel de la zone euro a été de 2,7% en mars 20112, contre 2,4% en février. Un an auparavant, il était de 1,6%. Le taux d’inflation mensuel a été de 1,4% en mars 2011.
Le taux d’inflation annuel de l’UE a été de 3,1% en mars 2011, contre 2,9% en février. Un an auparavant, il était de 2,0%. Le taux d’inflation mensuel a été de 1,1% en mars 2011.
Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne.
L’inflation dans les États membres de l’UE
En mars 2011, les taux annuels les plus faibles ont été observés en Irlande (1,2%), en Suède (1,4%) et en République tchèque (1,9%), et les plus élevés en Roumanie (8,0%), en Estonie (5,1%) ainsi qu’en Bulgarie et en Hongrie (4,6% chacun). Par rapport à février 2011, l’inflation annuelle a augmenté dans dix-huit États membres, est restée stable dans cinq et a baissé dans quatre.
Les taux moyens4 sur douze mois jusqu’en mars 2011 ont été les plus faibles en Irlande (-0,8%), en Lettonie (0,7%) et aux Pays-Bas (1,3%), et les plus élevés en Roumanie (6,8%), en Grèce (5,0%) et en Hongrie (4,3%).
Zone euro
Les principales composantes présentant les taux annuels les plus élevés en mars 2011 ont été les transports (5,6%), le logement (5,1%) ainsi que les boissons alcoolisées et le tabac (3,6%), tandis que les taux annuels les plus faibles ont été observés pour les communications (-0,6%), les loisirs et la culture (-0,3%) ainsi que l’équipement ménager (0,9%). Au niveau des sous-indices détaillés, les carburants pour le transport (+0,60 point de pourcentage), les combustibles liquides (+0,24) ainsi que l’électricité et le gaz (+0,10 chacun) ont eu les plus forts impacts à la hausse sur le taux global, alors que les télécommunications (-0,11), les loyers et les voitures (-0,09 chacun) ont eu les plus forts impacts à la baisse.
Les principales composantes présentant les taux mensuels les plus élevés ont été les articles d’habillement (15,1%), les transports (1,3%) ainsi que le logement et l’équipement ménager (0,6% chacun), tandis que les communications et les loisirs et la culture (-0,2% chacun) ainsi que la santé et l’enseignement (0,1% chacun) ont affiché les taux les plus faibles. En particulier, les vêtements (+0,67 point de pourcentage), les chaussures (+0,15) et les carburants pour le transport (+0,13) ont eu les plus forts impacts à la hausse sur le taux global. Les restaurants et cafés (-0,09), les loyers (-0,08) et les voitures (-0,06) ont eu les impacts à la baisse les plus marqués.
AGEFIPH publie un nouveau guide « Les stéréotypes sur les personnes handicapées. Comprendre et agir dans l’entreprise »
Sur la base des conclusions d’une étude menée en partenariat avec l’Agefiph, IMS-Entreprendre pour la cité publie un guide pratique « Les stéréotypes sur les personnes handicapées en entreprise. Comprendre et agir dans l’entreprise ».
Menée auprès de 400 managers de 4 grandes entreprises l’étude identifie les stéréotypes qui s’appliquent le plus souvent au handicap dans l’emploi. Elle mesure les facteurs et identifie les actions efficaces pour lutter contre ces idées toutes faites. Il ressort notamment que plus les managers perçoivent l’engagement de leur entreprise en faveur de la diversité, plus ils ont une image positive du handicap et des personnes handicapées. Cette appréciation est renforcée par l’importance des contacts professionnels avec des collègues handicapés.
Tirant les enseignements de cette études, le guide propose des pistes d’action concrètes aux entreprises pour lutter contre les stéréotypes et contribuer à améliorer l’intégration des collaborateurs handicapés.