Le profil des communicants territoriaux

www.cap-com.org
Mais qui sont donc les communicants des collectivités locales ? L’enquête Métiers de Cap’Com réalisée avec Occurrence et en partenariat avec le CNFPT apporte des chiffres précis sur leur âge, leur formation, leur statut, leurs parcours professionnels, la mobilité, les rémunérations, la formation continue et leurs sources d’information… Présentation commentée de la première partie de cette étude triennale qui fait référence dans la profession.
La communication au sein des collectivités locales poursuit sa professionnalisation. Aujourd’hui, pas moins de 15 000 agents, soit toutefois moins de 1% de la Fonction publique territoriale, exercent une véritable fonction de communication, interne ou externe, au sein des collectivités locales. Ils sont directeurs ou responsables de service communication, responsables ou chargés de communication ou de publications, graphistes, chefs de projets audiovisuels, multimédias, photographes, vidéastes… Ils travaillent au sein des directions ou services communication ou au sein d’autres entités, cabinet, DRH ou dans des services en charge de la promotion économique ou touristique, du Développement durable, de l’animation et de la participation des habitants…
L’enquête Métiers 2011 réalisée par Cap’Com et par Occurrence, en partenariat avec le CNFPT, permet de mesurer les évolutions de cette communauté professionnelle au regard notamment des enquêtes précédentes de Cap’Com conduites depuis une vingtaine d’années.
Retrouver cette présentation illustrée de tableaux dans la médiathèque Cap’Com. La présentation de cette première partie de l’enquête sera complété fin janvier par la présentation d’une seconde partie qui portera sur la fonction communication en collectivité locale : organisation, missions, moyens et outils…
La professionnalisation croissante du métier se traduit par un niveau de formation initiale en constante progression et par la montée en puissance des diplômes de communication.
Plus des deux tiers des communicants publics ont un niveau d’étude Bac + 4 et la tendance va sans doute se renforcer dans les prochaines années, dans la mesure où les nouveaux arrivants dans la profession sont plus diplômés que leurs aînés (74% des moins de 35 ans ont un niveau Bac + 4, contre 55% des plus de 45 ans).
L’analyse des disciplines attachées à ces diplômes montre également une montée en puissance de la communication comme principal champ de formation (et, parallèlement, une perte de vitesse des sciences humaines et du droit). Les lieux de formation cités reflètent également une diversification de l’offre de formation ces dernières années : multiplication des écoles spécialisées et des formations supérieures au sein des universités.
Rien d’étonnant donc qu’aujourd’hui près de 2/3 des communicants territoriaux appartiennent à la catégorie hiérarchique « A » de la FPT (8% pour l’ensemble des agents de la FPT).
Mais la féminisation de la profession et l’âge moyen relativement faible expliquent le maintien de rémunérations peu dynamiques.
Dans l’enquête Métiers réalisée en 2002, les femmes constituaient moins de la moitié (48%) de l’échantillon ; elles représentent aujourd’hui plus des deux tiers des effectifs (69%), un chiffre qui a dépassé le taux de féminisation de l’ensemble de la FPT (61%). Toutefois les femmes n’occupent que 59% des postes de directeurs de la communication.
L’âge moyen du communicant territorial évolue peu, autour de 38 ans, et la profession compte 39% de moins de 35 ans, ce qui en fait l’un des métiers parmi les plus jeune de la FPT. Les plus jeunes recrues (moins de 35 ans) sont des femmes pour environ les trois-quarts.
Cette situation explique la stagnation, malgré la progression des compétences, du niveau des rémunérations. Globalement la moitié des communicants territoriaux gagne moins de 30 000 € brut par an et seulement 20% plus de 40 000 €. Le salaire médian d’un directeur de service communication au sein d’une collectivité locale se situe entre 35 et 40 000 € brut par an (primes et avantages inclus), celui d’un responsable de communication autour de 30 000 €, celui d’un chargé de communication entre 20 et 25 000 €. Notons toutefois que les disparités de rémunérations sont assez importantes en fonction du statut (les titulaires ont un niveau de rémunération moins élevé), du poste, de l’âge, du sexe (les hommes gagnent davantage que les femmes) et de la taille de la collectivité.
Les perspectives de carrière jugées intéressante dans la communication poussent à une mobilité relativement forte notamment en direction du secteur privé. Mais l’attachement à certaines valeurs maintient une spécificité au métier dans le secteur public.
Les métiers de la communication apparaissent garder des perspectives de carrières intéressantes pour 80% des communicants territoriaux, un résultat en hausse par rapport à 2008 (75%). Et la perspective de pouvoir continuer d’exercer ce métier au sein du secteur public reste aussi forte en 2011 qu’en 2008 (75%). La professionnalisation entraine toutefois une diminution de la perspective d’exercer un autre métier au sein du secteur public (47% en 2008, 59% en 2011). La professionnalisation dans le métier de la communication conjuguée à la connaissance du fonctionnement du secteur local ouvrent des perspectives au sein du secteur privé où les rémunérations sont plus attractives. L’ancienneté relativement faible dans le poste en collectivité locale traduit cette mobilité en partie au sein de la FTP mais aussi hors secteur public. La moitié des communicants actuellement en poste dans une collectivité locale a déjà eu l’occasion de travailler ailleurs qu’en collectivité et plus du tiers a déjà travaillé dans le privé.
Mais le communicant territorial reste fortement attaché aux spécificités de son métier dans le secteur public. L’attachement à la vie locale et au service public constituent, avec l’intérêt porté aux enjeux politiques, les trois principales raisons du choix de la territoriale – les deux premières ayant d’ailleurs tendance à prendre le pas sur le politique.
La professionnalisation comme la mobilité conduisent à des besoins d’information et formation continue auquel répond en grande partie le réseau professionnel.
Malgré une formation initiale plus poussée notamment en communication, des besoins de formation continue se font sentir pour accompagner les évolutions des outils et des responsabilités. Par exemple, la révolution du web social nécessite des formations sur l’usage des TIC. La progression dans le poste conduit aussi à des formations en management et en stratégie. Et la mobilité avec le secteur privé invite à se familiariser avec le cadre juridique de fonctionnement du secteur public.
Le CNFPT et Cap’Com sont les deux principaux organismes cités qui répondent à ce besoin de formation des communicants territoriaux.
Mais au delà de la formation, pour leur information professionnelle et pour suivre l’actualité de leur profession, les communicants territoriaux disposent d’outils qu’ils utilisent largement. Au premier rang, ils sont utilisateurs du Web, du site de leur réseau professionnel et des sites de la presse généraliste ou spécialisée.
La lecture de la presse reste toutefois importante notamment de presse professionnelle mais davantage celle secteur local que celle du secteur de la communication.
Certains acteurs sont particulièrement identifiés parmi les sources d’information notamment celle de leur réseau professionnel Cap’Com ou les titres leaders de la presse professionnelle.
Publié le 10 janvier 2012, dans Non classé, et tagué Collectivités, collectivités locales, communication, formation, ressources humaines. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.
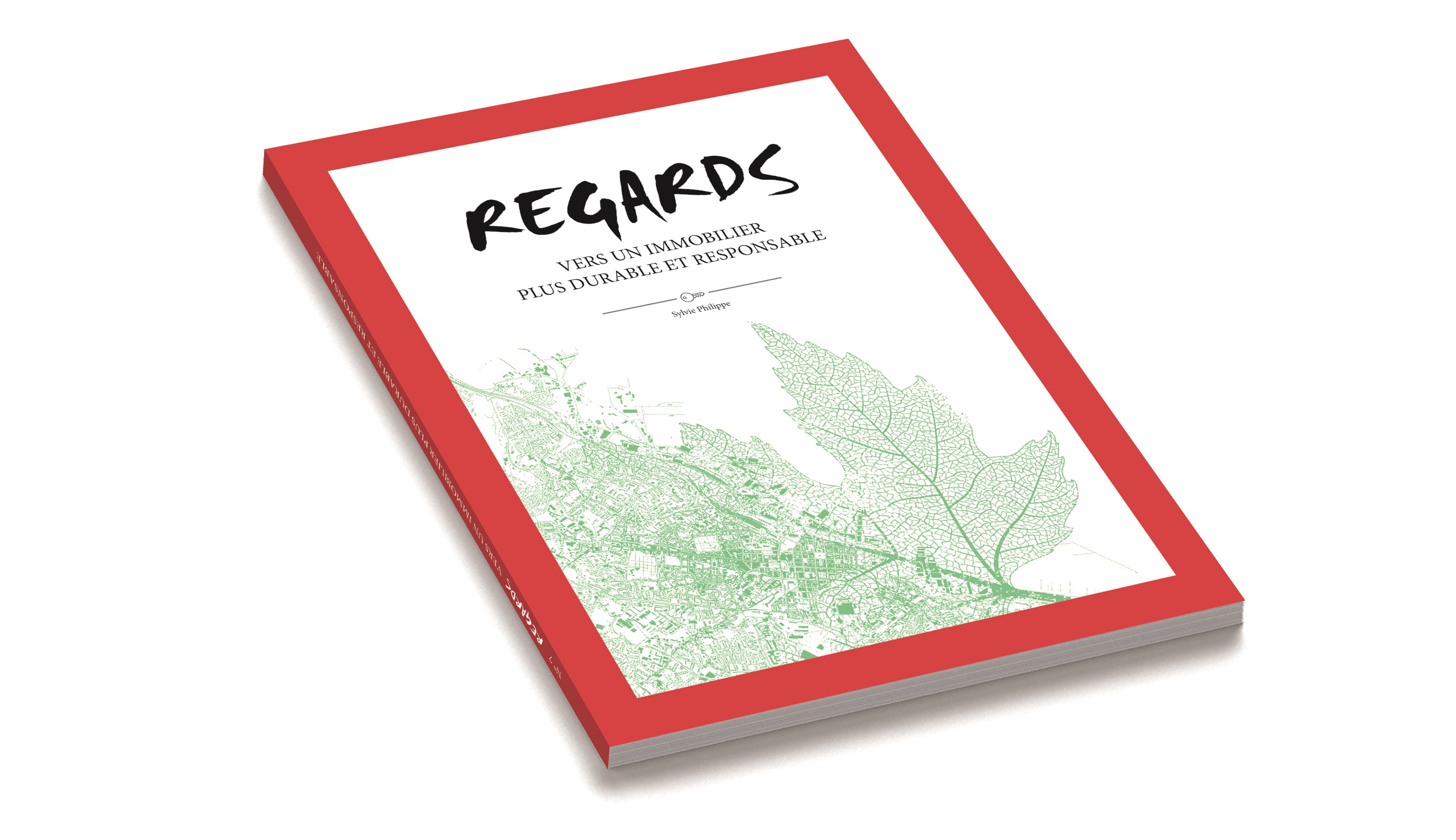
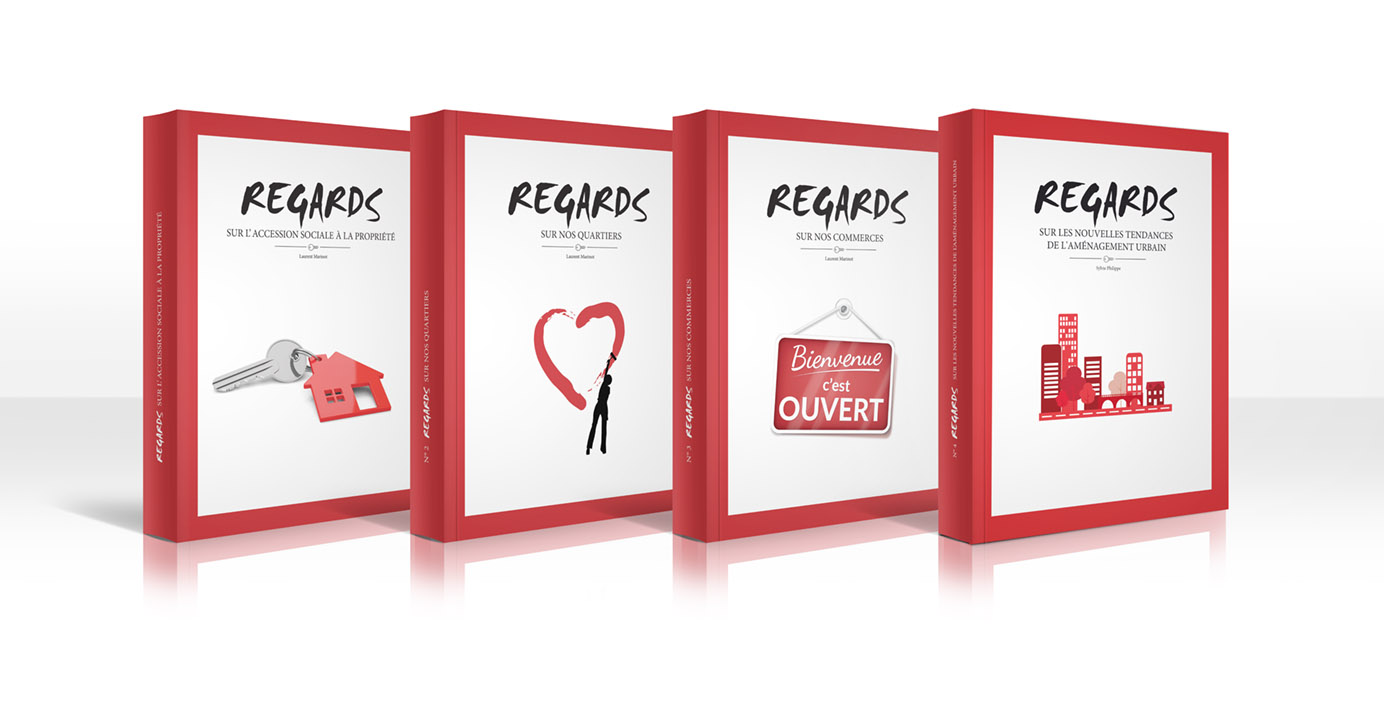

Poster un commentaire
Comments 0