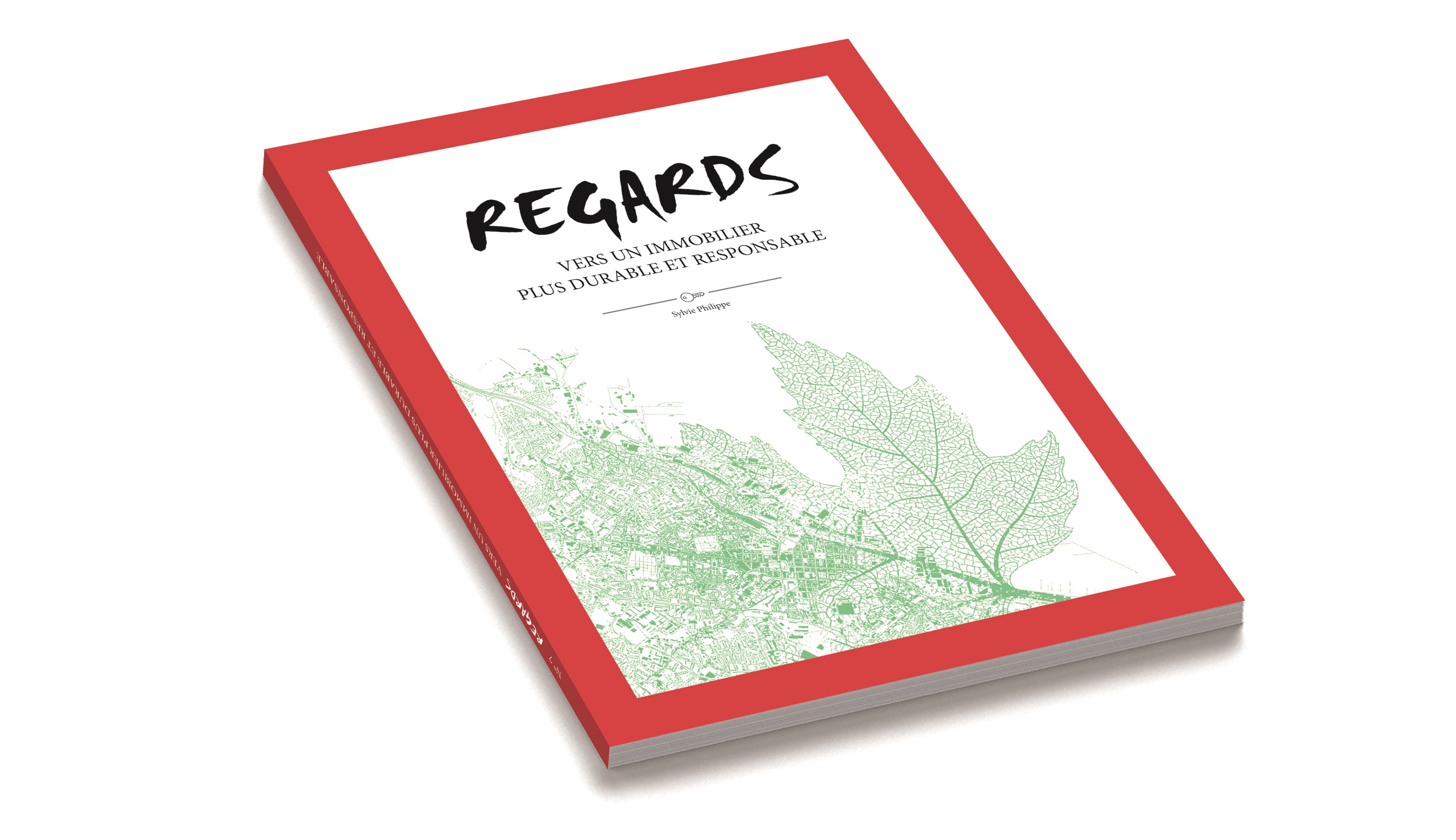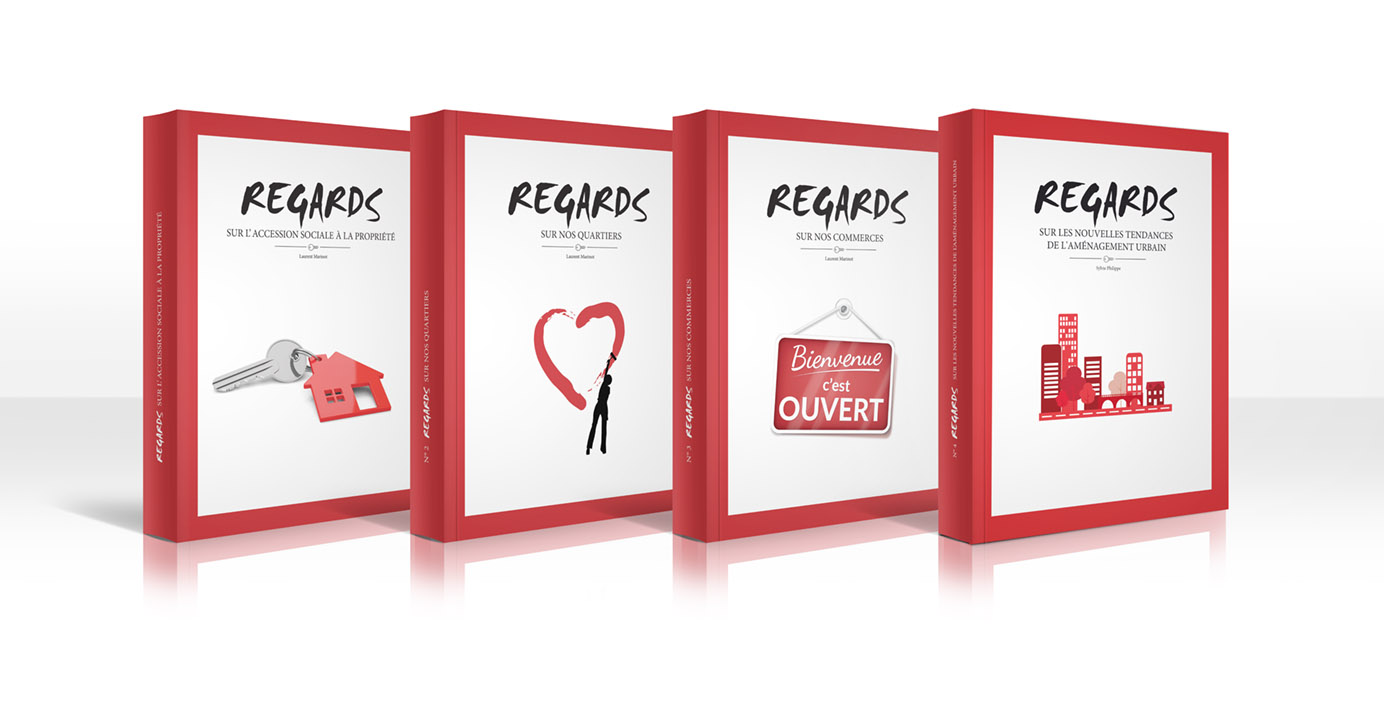Archives d’Auteur: Alexandra Poloce
Olivier Salleron a été élu Président de la Fédération Française du Bâtiment @FFBatiment
Source : Fédération Française du Bâtiment

Olivier SALLERON a été élu Président de la Fédération Française du Bâtiment au cours du Conseil d’Administration du vendredi 20 mars 2020.
Sa prise de fonction interviendra le vendredi 12 juin 2020, à l’issue du prochain Conseil d’Administration de la FFB.
Il succèdera à Jacques CHANUT, Président depuis 2014.
Âgé de 52 ans, Olivier SALLERON est Président de l’entreprise de chauffage, climatisation, plomberie SALLERON SAS à Périgueux (24).
Il est actuellement Vice-président et Président de la Commission Sociale de la FFB, ainsi que Président de la Fédération Régionale Nouvelle Aquitaine.
Doctolib met gratuitement à disposition de tous les médecins son service de téléconsultation #COVID_19
Confinement : de nouvelles solidarités portées par les marques
Doctolib renforce son engagement contre le Covid-19 en mettant à disposition gratuitement sa plateforme de téléconsultation à tous les médecins de France.
La consultation vidéo est une des solutions pour permettre d’orienter, de soigner et de suivre les patients à domicile tout en limitant la propagation du virus. Doctolib a décidé de renforcer son engagement contre la progression du virus en mettant à disposition gratuitement la consultation vidéo pour tous les médecins de France. La société financera intégralement les coûts d’équipement, de formation et de gestion de ce service.
Depuis plusieurs jours, Doctolib est mobilisé pour informer les patients et les professionnels de santé sur la situation relative au Covid-19 en lien avec le Ministère des Solidarités et de la Santé :
Droit de réponse de Vassilli Perrinet suite à l’aricle publié sur notre blog le 17 décembre 2019
« Propriétaire de plusieurs biens immobiliers dans le département des Hauts-de-Seine, j’ai effectivement déposé, en mon nom ou en qualité de représentant de ma société, plusieurs recours à l’encontre de permis de construire, entre les mois d’août 2018 et de décembre 2019.
Cette démarche était légitime et avait pour unique objet de prévenir toute atteinte à mon droit de propriété ou à celui de ma société. Le nombre de chantiers dans le département des Hauts-de-Seine, particulièrement dans certaines communes, est considérable et les nuisances afférentes sont indéniables.
Cette démarche ne peut aucunement s’apparenter à une procédure illégale ou abusive.
En premier lieu, le nombre de recours formés est, en effet, dérisoire par rapport au nombre de permis de construire déposés, chaque année, au sein des Hauts-de-Seine. À titre illustratif, ma société ou moi-même avons été parties à 4 recours contentieux durant l’année 2018, alors que 1479 permis de construire ont été accordés, sur la même période, au sein de ce département (source : data.gouv.fr).
En second lieu, tous les recours formés visaient à contester des permis de construire de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de onze biens immobiliers, acquis entre 2011 et 2017 soit bien antérieurement aux permis de construire – conformément à l’article L600-1-2 du code de l’urbanisme. Tous les recours formés étaient, en outre, uniques et ont été rédigés de manière circonstanciée et spécifique à l’encontre de permis de construire qui, selon moi, violaient les règles d’urbanisme.
A la suite de ces recours, certains titulaires des permis de construire concernés m’ont approché afin d’indemniser le préjudice que je subissais en contrepartie de mon désistement au recours. En aucun cas je n’ai sollicité de leur part le versement d’une quelconque somme d’argent.
Lorsque les procédures n’ont pas pu être résolues amiablement, aucun des recours déposé n’a été jugé abusif par les juridictions administratives.
Dans ces conditions, je conteste la plainte pénale infondée déposée à mon encontre par la Fédération des Promoteurs Immobiliers d’Ile-de-France (FPI-IDF).
Au regard de la gravité des faits reprochés et des conséquences fortement préjudiciables qu’ont causé leur révélation et la divulgation de mes données personnelles – notamment la perte de mon emploi-, je me réserve le droit de porter cette affaire devant les juridictions compétentes.
Pourquoi et comment transformer une Scp d’Hlm en scic Hlm ? @lesCoopHlm
Source : les Coop’ HLM

Un décret du 11 mars 2020 déconcentre l’instruction des autorisations de transformation relatives à la loi du 1er août 2003 a introduit dans le CCH une nouvelle catégorie d’organismes d’Hlm.
La loi du 1er août 2003 relative à la ville et à la rénovation urbaine introduit dans le code de la construction et de l’habitation une nouvelle catégorie d’organismes d’Hlm : la société coopérative d’intérêt collectif d’Hlm, plus communément désignée comme « Scic Hlm ».
Pourquoi se transformer en Scic Hlm ?
Les coopératives d’Hlm estiment que cette forme juridique, par l’organisation plus souple des collèges d’associés, favorise les partenariats autour de projets sociaux et économiques locaux en faveur du logement des ménages modestes, dans le respect des valeurs de l’économie sociale qui les animent.
L’intérêt de la transformation en Scic ne tient ni à l’objet social stricto sensu ni au régime fiscal d’exercice de l’activité car ceux-ci sont identiques dans une Scic Hlm à ceux d’une Scp d’Hlm.
Il repose sur la notion de l’intérêt collectif qui n’a pas à se trouver formalisé dans une Scp d’Hlm ou une Scla alors qu’il est consubstantiel et nécessaire dans une Scic Hlm. Il vient aussi de la souplesse de l’organisation du sociétariat qui permet de prendre en compte et de traduire dans les conditions d’admission et de retrait comme dans les modalités de répartition des droits de vote, la diversité du sociétariat qui existe aujourd’hui dans les Scp d’Hlm, l’évolution de son effectif, de son poids au sein de la coopérative comme à l’extérieur de celle-ci.
La Scic, par sa souplesse d’organisation, favorise aussi l’implication d’acteurs tels que :
- Les collectivités territoriales,
- Les organismes de l’économie sociale et du logement social,
- Les personnes qualifiées, les bénévoles et les personnes physiques appelées les « participants »,
- Les entreprises du secteur privé (par exemple les établissements de crédit),
- …
Ces acteurs peuvent ainsi se voir reconnaître une place dans la prise de décision qui ne soit pas en rapport avec la part de capital détenu mais en relation avec l’implication et le soutien qu’ils apportent au projet économique et social de la coopérative d’Hlm.L’adoption du statut de Scic Hlm constitue une étape de la mutation entreprise avec la loi de 1992. Ce statut affirme la place occupée, aux côtés des coopérateurs utilisateurs, par les personnes morales investisseurs et par les salariés. Ce faisant, la Scic Hlm, par la place moindre qu’elle peut faire aux utilisateurs, pourra également résoudre de nombreux cas d’étiolement du « collège A » constaté dans les Scp d’Hlm.
Unafo salue le report de la contemporanéité du calcul des aides au logement (APL) @UnafoUnion
Source : UNAFO

Le Ministre du Logement vient de confirmer le report de la mise en œuvre de la contemporanéité du calcul des aides au logement, après les déclarations hier du Président de la République, qui avait annoncé la suspension de toutes les réformes en cours. L’Unafo, qui avait demandé cette mesure, salue cette décision.
L’entrée en vigueur de la réforme du calcul des aides au logement, avec l’introduction de la contemporanéité était prévue le 1er avril prochain.
Avant l’intervention du Président de la République, l’Unafo avait réclamé le report de cette entrée en vigueur. En effet, les adhérents de l’Union, gestionnaires de résidences sociales, lui avaient fait part de leur inquiétude sur la mise en application, à cette date, de la réforme et de leurs craintes de ruptures de droit massives.
Elles auraient été, en effet, dans l’incapacité de maintenir un accompagnement approprié dans un contexte de forte perturbation de leur activité du fait de la crise sanitaire actuelle. De nombreux salariés vont être absents en raison de la fermeture des écoles et les salariés présents vont concentrer leur action sur l’information et la sensibilisation des résidants au respect des consignes de prévention et sur la mise en œuvre des directives données dans le cadre de la lutte contre le développement de la pandémie.