Réforme des marchés publics: quels changements dans le décret du 25 mars 2016 ?

Après l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, viennent d’être publiés ses très attendus décrets d’application, dont l’un s’applique à tous les marchés, y compris de partenariat, à l’exception des marchés publics de défense et de sécurité qui sont régis par l’autre décret. Les deux décrets du 25 mars 2016, tout comme l’ordonnance, sont entrés en vigueur dès le 1er avril 2016.
Ainsi, tous les marchés « pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication » depuis le 1er avril 2016 sont soumis à cette nouvelle règlementation.
Pour mémoire, ces dispositions ont pour objet, d’une part, de transposer les nouvelles directives « marchés » n° 2014/24 et 2014/25 du 26 février 2014 et, d’autre part, de rationnaliser la commande publique à travers la création « d’un corpus unique » de textes régissant l’ensemble des marchés publics. Ainsi, pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, anciennement soumis au Code des marchés publics comme à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés publics passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, relèvent désormais des mêmes textes.
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics, est porteur d’évolutions et d’innovations dont les principales sont ici évoquées.
1. Identification renforcée des besoins
Les acheteurs peuvent désormais expressément recourir, préalablement à toute consultation, à des échanges avec les opérateurs économiques ou encore à la réalisation d’une étude de marché. Ils sont toutefois tenus de ne pas « fausser la concurrence », ni porter atteinte aux principes de la commande publique. Inversement, ils sont tenus de « prendre les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée » (art. 4 et 5).
Si l’ordonnance de 2015 a par ailleurs généralisé le principe de l’allotissement à tous les marchés publics et imposé de justifier le recours à un marché global, ce qui impacte fortement les procédures des acheteurs relevant jusqu’alors des dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005, le décret précise que cette justification doit figurer dans les documents de la consultation (art. 12).
2. Dématérialisation et transparence
A compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs, tous sont tenus de dématérialiser leurs procédures de passation et d’effectuer au moyen de communications électroniques tous leurs échanges d’informations (art. 38 à 42). A cette fin, d’une part, les documents de la consultation devront être gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur le profil d’acheteur (art. 107) et, d’autre part, toutes les communications et tous les échanges d’informations devront être effectués par des moyens de communications électroniques.
Toutefois, ce principe connaît de nombreuses exceptions.
En outre, le décret impose aux acheteurs, au plus tard le 1er octobre 2018, de publier, sur leurs profils d’acheteur, un certain nombre de données essentielles concernant non seulement l’attribution mais également les modifications apportées à leurs marchés publics, et ce quel que soit leur montant. Echappent toutefois à cette obligation de publication les informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.
3. Sélection des candidats, examen des offres et prise en compte d’objectifs de développement durable
Les modalités de sélection des candidatures et de jugement des offres ont été considérablement assouplies. Désormais, l’acheteur aura la possibilité de vérifier les capacités des candidats à tout moment de la procédure, jusqu’à l’attribution du marché public (article 55), et d’examiner les offres avant les candidatures et ainsi de vérifier uniquement la recevabilité de la candidature accompagnant l’offre économiquement la plus avantageuse (article 58). La faculté de régulariser les offres lui est également offerte, sous certaines conditions (article 59).
S’agissant par ailleurs des offres anormalement basses, l’appréciation du caractère anormalement bas peut désormais se faire au regard les obligations applicables dans les domaines du droit de l’environnement, du droit social ou encore du droit du travail (article 60).
Le décret accroît plus largement les possibilités de prise en compte d’objectifs de développement durable, tant dans la définition des besoins à travers les spécifications techniques et labels (art. 4 à 11), que dans les critères de sélection des candidatures et de jugement des offres (art. 44 et suivants) ou encore dans les conditions d’exécution du marché. En particulier, est introduite la faculté de prendre en compte le coût de cycle de vie, notion avec laquelle il reviendra aux acheteurs de se familiariser (art.62 et 63).
Publié le 2 Mai 2016, dans Actualités, Collectivités, et tagué marchés publics, seban et associes. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.
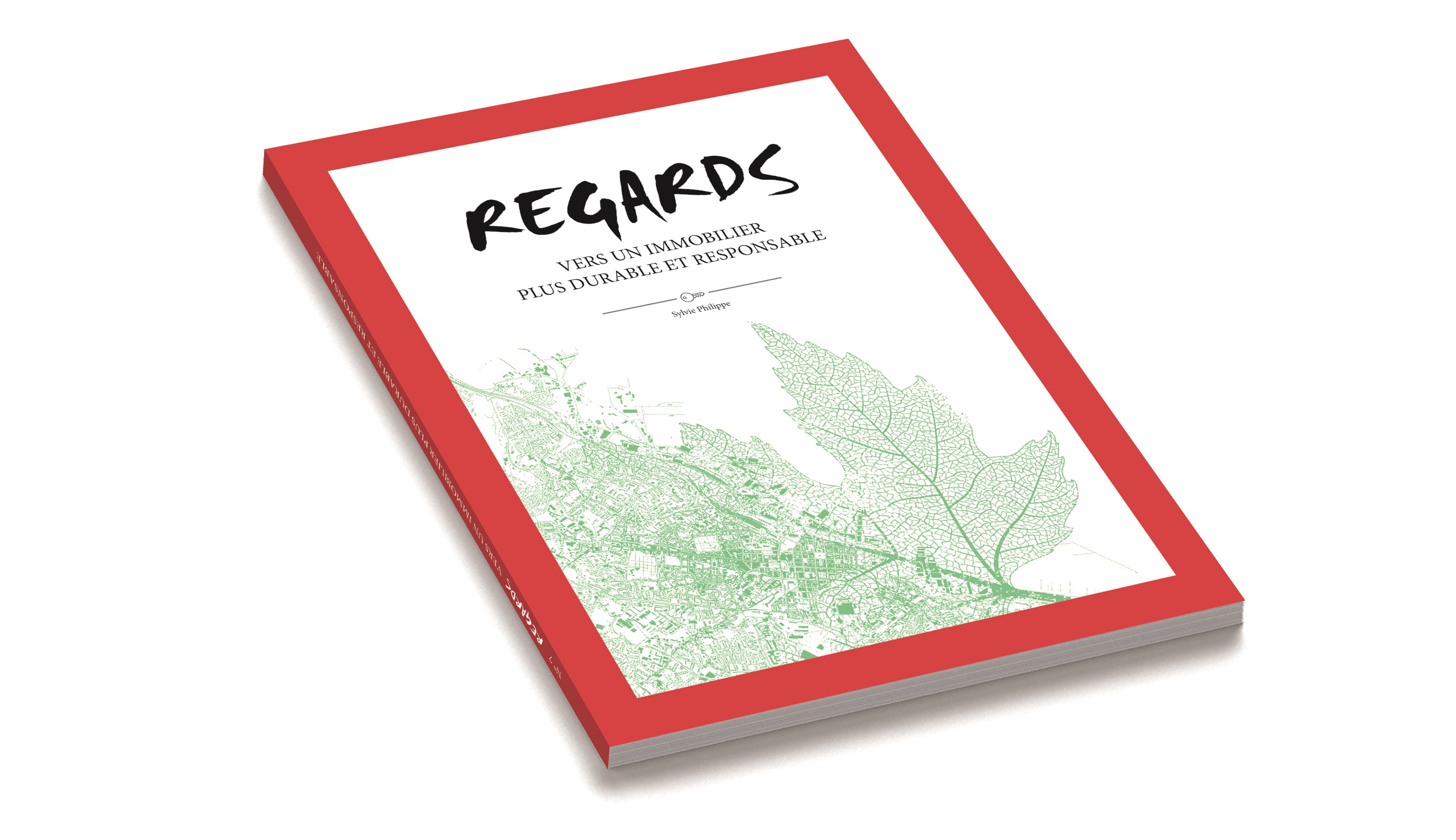
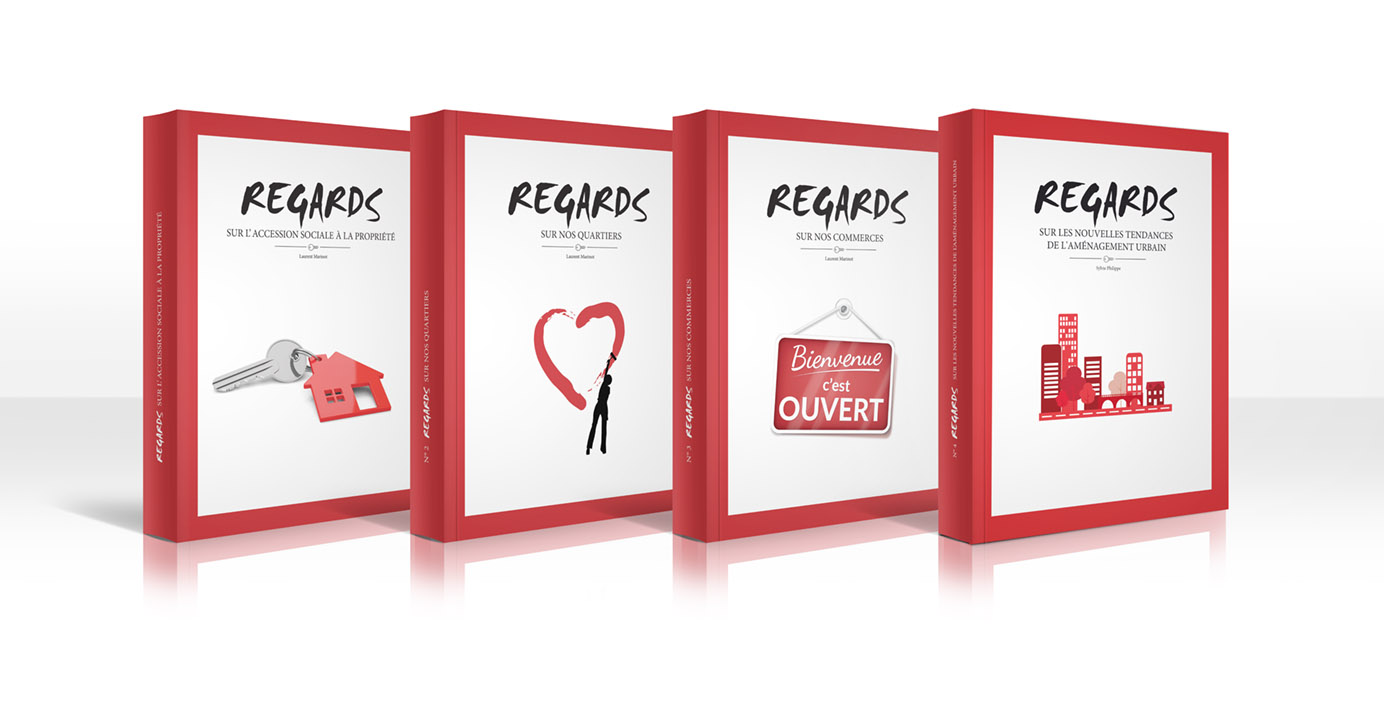

Poster un commentaire
Comments 0